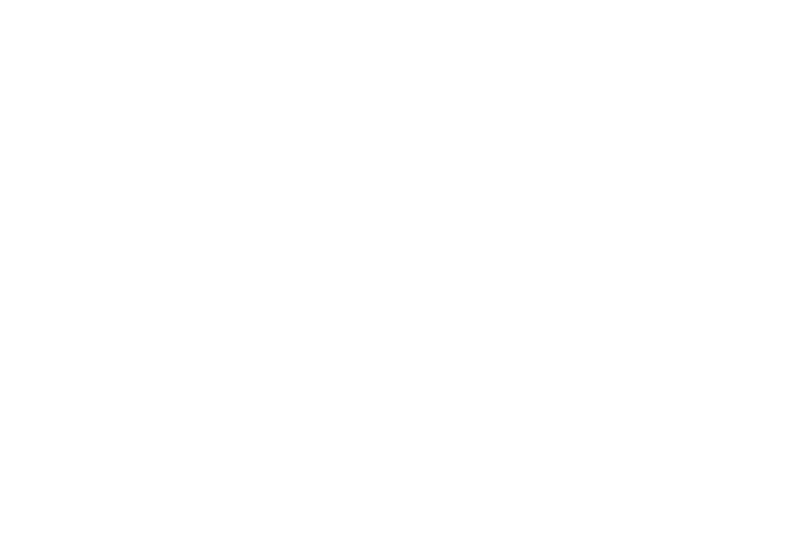ÉCRIRE DESSUS #5
PAR DAVID SANSON – SOUVENIRS DE 2018
Concerts des dimanche 25, mardi 27
& jeudi 29 novembre 2018, Bordeaux
Azimut, toutes ! du 5 au 8 décembre, Bayonne
Comment le langage d’un musicien, son vocabulaire se transforment-ils suivant qu’il se produit seul ou avec d’autres, ou qu’il change d’instrument ? Quelles sont les mille et une manières de décrire une voix, de quelles matières les cordes vocales sont-elles tressées ? Qu’est-ce qui sépare un duo d’un duel, un jeu d’une joute ? Comment certaines musiques que l’on aurait tort de croire « difficiles » parviennent-elles à produire sur leur auditoire une aussi évidente magie ? Et comment les mots peuvent-ils être aptes à traduire ce qui se joue dans ses instants, à travers ces flux de musique qui charrient et activent, parfois à contre-temps, irrépressiblement, autant de flux de conscience ?
Telles sont quelques-unes des passionnantes (et éternelles) questions que les 11 concerts dont il sera question ici – impliquant une douzaine d’artistes répartis sur 6 soirées ou matinées, de Bordeaux à Bayonne et du 25 novembre au 8 décembre – ont eu en commun de soulever. Au-delà des quelques invariants – la liberté, la virtuosité, la convivialité, la curiosité – décidément propres aux soirées d’Einstein On The Beach (comme, à Bayonne, de Bastringue). Au-delà aussi des instruments en présence : la voix en premier lieu (avec Catherine Jauniaux, Isabelle Duthoit et Natacha Muslera, brelan de vocalistes incomparables), mais aussi la guitare (Jean-Sébastien Mariage, Monsieur Gadou…), la violon et l’alto (Prune Bécheau, Tiziana Bertoncini), les percussions (Camille Emaille) ou les lutheries électroniques bricolées par Jean-Marc Reilla, alias Cabine Volcan – précisons que j’ai malheureusement manqué les performances de ces deux derniers…
Flashbacks en rafale.
~ ÉPISODE CINQ.UN : Bordeaux, Ô plafond, 25 novembre
Odes maritimes, corps électriques
D’abord, un nouvel endroit, un dimanche 25 novembre après-midi, sur cette mini rue Saint-Vincent-de-Paul, reliant la gare Saint-Jean au cours de la Marne, que l’on emprunte si souvent sans y prêter attention :
Un bien joli – vintage, diraient certains – et accueillant bar associatif, en l’occurrence celui d’Ô plafond, association ayant pour objet de « favoriser la création, la diffusion autour de la culture et de la permaculture ». Dans ce lieu hybride, on croise pour la première fois les protagonistes du jour, que l’on connaît depuis longtemps, au moins de nom. Jean-Sébastien Mariage, guitariste chevronné et indiscipliné frayant au sein d’une multitude de formation et à la tête du site « vitrine » Inversus Doxa (dont j’avais par erreur, dans mon texte de présentation, attribué la paternité Frédérick Galiay, son partenaire au sein du duo free-rock Chamæleo Vulgaris). Et puis les deux « chanteuses », Catherine Jauniaux et Natacha Muslera – les deux voix plutôt, les deux corps – avec lesquelles il va se produire successivement. Les gens arrivent, discutent, s’installent, se taisent. Ça commence avec Catherine Jauniaux.
La pièce s’intitule Vibrer, sobrement mais pertinemment. C’est le versant concertant de ce qui fut à l’origine une composition électroacoustique, elle-même inspirée d’un dessin de Marie-Françoise Lequoy-Poiré dont la reproduction – sur un long rouleau horizontal, un trait sinue, par endroits comme brouillé, figurant lointainement, ainsi qu’on l’apprendra après le concert, le reflet d’un mât sur une onde miroitante – est accroché au mur au-dessus du duo. Il figure aussi (ce dessin) la trame de la « partition » que les deux musiciens se sont fait fort d’interpréter, graphique dont la reproduction trône aussi sur leurs pupitres.
Et de fait, la musique sinue, se déploie et se brouille, comme à la surface d’une onde miroitante, tout au long de ce concert qui débute par des arpèges suraigus, joués sur le manche de la guitare ; de la gorge de Catherine Jauniaux, ou de ses appeaux, s’échappent des bruits de forêts frémissant de chants d’oiseaux, comme des glitches bucaux ; bientôt, on perçoit des vocalises lointaines. Alors on est rapidement comme en apesanteur, happé ou immergé dans ce flux sonore, embarqué par son rythme « fluvial » (pour reprendre le titre du magnifique premier disque gravé par Catherine Jauniaux, avec Tim Hodgkinson, il y a… 35 ans), ou plutôt maritime, en tout cas élémentaire. Flux impalpable et pourtant parcouru d’une infinité de gestes infimes, quasi imperceptibles (d’où vient par exemple ce bruit de fond qui, peu à peu, commence à sourdre des hauts-parleurs ?), gestes qu’il suscite et qui à leur tour le transforment…
L’archet arrache à la guitare des mugissements de baleine (mais la baleine chante et ne mugit pas) ou des souffles abyssaux, et puis c’est à l’e-bow d’en tirer un lamento qui semble celui de la sirène de quelque invisible navire… et la voix à son tour de se faire sirène, par la grâce de quelque glissando sémantique, « démon marin femelle représenté sous forme d’oiseau ou de poisson avec tête et poitrine de femme et dont les chants séducteurs provoquaient des naufrage »… Ensorceleuse est bien cet organ(ism)e qui sinue autour des notes, s’y frotte, joue avec elles en autant d’effets de texture ou d’homophonie, nouant avec la guitare, de glissandi en micro-intervalles, une joute éloquente, à défaut d’être oratoire. Je pense à l’entendre au titre de cette chanson, l’une des plus belles des Young Gods : Fais la mouette… Catherine Jauniaux est un oiseau rare, et même un spécimen unique ! Bientôt, de puissantes harmoniques dans les basses font naître une houle fantomatique qui à son tour s’apaise, jusqu’à ce que l’on retourne au silence, comme le dessin d’un mât finit toujours par déboucher sur du blanc… Silence qui est aussi celui du spectateur, plongé un rare état de sidération, comme revenu à bon port après un grand voyage, cheminement autant que traversée, ou comme tiré de sa contemplation :
« Ah, qui sait, qui sait
Si je ne suis point déjà parti, autrefois, avant moi-même,
D’un quai ; si je n’ai point déjà quitté, navire au soleil
Oblique de l’aurore,
Une autre espèce de port ? »
ainsi que le chantait un fameux poète hétéronyme portugais…
On accoste au bar, un verre pour diluer la torpeur, et avec Bertrand, on prononce (j’ai pris note) les mots « envergure » et « profondeur », on s’extasie devant la simplicité et la précision des gestes musicaux qui viennent de produire ce poignant spectacle auriculaire…
(Aparté n° 1 : Et à l’écoute de ce duo spectral, comme lors de beaucoup des concerts qui vont suivre, je me poserai une nouvelle fois la question : comment se fait-il que les lieux institutionnels dédiés à la musique dite « contemporaine » (sous-entendu : savante, écrite, de tradition occidentale) demeurent si sourds à ces expressions musicales dont le résultat sonore n’a rien à envier, en termes de raffinement et de richesse, aux œuvres de maints compositeurs officiels – et dont le résultat musical est d’une intensité autrement plus grande ? Oui, il faut abattre les barrières qui empêchent les musiques de recherche – fussent-elles savantes ou improvisées, acoustiques ou électr(on)iques – de communiquer entre elles, et de faire front commun !)
… et puis on regagne nos sièges.
Autant le concert que Jean-Sébastien Mariage vient de donner avec Catherine Jauniaux était horizontal, abandonné à un continuum parfois flouté, mais toujours linéaire, autant celui qui l’unit à Natacha Muslera est vertical, sec et saccadé, tout en hachures, tension/détente et permanentes ruptures de ton. Si, dans la table des éléments, Catherine Jauniaux pourrait incarner l’eau, alors sa cadette, extravertie, énergique, surexcitée, figure la fille du feu. Il y a quelque chose de fantomatique, de spectral, dans la prestation de ce duo, ces gestes et ces accords de guitare, ces souffles brutalement assénés dans le micro. On a parfois l’impression d’entendre un rock expressionniste, fait de standards désossés, des échos biffés de chansons, tour à tour suaves et électriques, parlés ou bruités. Quelque chose d’intemporel aussi, d’immémorial et de sauvage : on se demande si l’on est bien dans les années 2010 ou si les happening des années 1970 ne ressemblaient pas aussi à cela, on se demande : cette musique n’a-t-elle pas toujours été là ? Cette débauche d’énergie, cette transe tout en chausse-trapes, joute à noblement parler – d’autant que Jean-Sébastien Mariage nous confirmera après-coup le caractère totalement improvisé de la chose – qui semble mener tout le monde au bout du souffle… Leur duo s’appelle Baise en ville.
~ ÉPISODE CINQ.DEUX : Bordeaux
Centre d’animation Saint-Pierre, 27 et 29 novembre.
« La musique est vocale, autrement elle n’existe pas. »
On retrouve deux jours plus tard les mêmes chanteuses au Centre d’animation Saint-Pierre, où leur duo Anorak se produit en conclusion un nouveau « Mardi au Zinc Pierre ». Auparavant, j’aurai successivement :
– raté le set de Cabine Volcan, au sujet duquel, plus tard – et cela ne fera qu’attiser mes regrets ! –, j’entendrai prononcer les mots « flippant » et « gaudriole » ;
– suivi distraitement celui de Jeff Zima, étant d’une part un peu accaparé par ma fille, et de l’autre très modérément fan de blues. Musique dont je sais bien qu’elle est à la source de presque tout mais que, j’ose l’avouer, je ne suis pas (pas encore) parvenu à comprendre – alors même que j’écoute beaucoup de musique baroque, pourtant beaucoup plus lointaine, et tout aussi forclose dans des schémas d’écriture (comme dans le blues, on peut toujours prévoir l’accord qui va suivre). J’aime écouter les vieux enregistrements de musiciens du Mississipi (surtout lorsqu’ils sont mixés par Stephan Mathieu avec d’autres vieux 78 tours de toutes sortes, comme dans ce merveilleux podcast réalisé pour le label Crónica, On The Concept Of History (.mp3) – Yan, si tu me lis, écoute ça, c’est pour toi !), mais alors les craquements du vinyle et les distorsions accidentelles du son entrent au moins autant que la musique dans l’émotion que j’éprouve…
Tout cela pour dire qu’à la différence de la plupart de celles et ceux avec lesquels j’en ai parlé après, j’ai plutôt apprécié ce concert. Parce que, d’abord, le jeu de guitare de Zima m’a assez fasciné par sa dextérité et son naturel, comme s’il semblait porter en lui des décennies d’idiome blues – cet idiome qu’il a patiemment servi et affûté au fil de sa longue carrière franco-américaine, notamment dans les rues de la Nouvelle-Orléans – du Sud-Ouest des Etats-Unis à celui de la France, en somme. Peut-être parce qu’ensuite, je n’ai prêté qu’une oreille intermittente à des textes en français que beaucoup de mes interlocuteurs ont jugés pour le moins maladroits. Pour ma part, le choix du français a paradoxalement renforcé mon intérêt : il m’a par exemple permis de réaliser combien la dimension de « chroniqueur », de raconteur d’histoires, est indissociable de la figure du bluesman, comme de celle du griot ou du troubadour ; il a aussi favorisé certaines associations esthétiques incongrues, peut-être encouragées par la présence de ma fille – oserai-je dire que j’ai parfois pensé à… Henri Dès ? Henri Dès dont j’ai intégré le répertoire jusqu’à la nausée à la faveur d’un été – par ailleurs merveilleux – dans la Drôme ? Il est vrai, en revanche, que les textes de Zima étaient peut-être un peu abscons pour une enfant… Bref, un concert clivant, comme disent les journalistes neutres.
Rien de comparable, en tout cas, avec ce qui s’ensuit. Anorak en effet nous fait entrer dans une tout autre dimension musicale et sonore. C’est bien simple – et, en l’occurrence, bon signe –, je n’ai quasiment pas écrit un mot durant tout ce concert, non pas tant en raison de l’heure avancée (elle ne l’était après tout que moyennement) que parce que j’ai été totalement médusé par le face-à-face de ces deux musiciennes, Gorgones ou pythies, artistes vocales et totales dont les palettes respectives font naître, lorsqu’elles se rencontrent, une myriade de textures neuves. Face-à-face la fois théâtral et animal, spectaculaire et intérieur, performance qui sidère d’autant plus qu’elle est comme à chaque fois totalement improvisée, à laquelle les appeaux ou les développements phonographiques insufflent une dimension organique et immémoriale. Et face à laquelle les mots sont de piètre importance en regard de l’émotion du moment – même si j’ai eu envie d’assommer le spectateur qui, au premier rang, a pollué les dernières minutes du concert par des bâillements aussi inopportuns qu’inélégants, alors même que les deux chanteuses s’évertuaient à nous entraîner avec elles aux confins du silence… C’est en tout cas en admirant Catherine Jauniaux et Natacha Muslera ce soir-là – leur courage, leur engagement, leur impudeur – que j’ai commencé à songer à la différence qui peut exister entre deux voix – leur timbres, leurs textures, leurs vocabulaires –, mais aussi à mesurer la dimension élémentaire de cet instrument-organe qui tient du minéral ou du végétal, de l’aquatique ou du tellurique… Finalement, ne serait-ce pas aussi ça, le blues ?
Deux nouveaux jours plus tard, je suis au même endroit, mais à midi cette fois, pour retrouver Los Dos Hermanos – le duo formé, rappelons-le, par Yan (Beigbeder) et Monsieur (Gadou) – pour une fort plaisante partie de ping-pong musical apéritive. Los Dos Hermanos cultivent l’une des qualités les plus précieuses qui soient : la curiosité, et le sens de l’hospitalité. On aimerait juste qu’il y a ait davantage d’apprentis curieux aux apéros proposés par ce « duo improbable entre un collectionneur de disque et un guitariste » (c’est en ces termes que le présente le premier dans son laïus introductif), qui nous entraîne ce jour-là du côté du Maroc – pays dont la gastronomie est au coeur du repas partagé avec les convives…
Cadavre exquis sonore, musique de table ou d’ameublement (on pense furtivement à Satie et ses Gnossiennes au détour d’une improvisation en mode grec), nos « deux frères » nous font prendre le taksim – du nom de ces préludes au tempo lent confiés à un instrument soliste dans les traditions musicales arabe et turque – pour une virée en grand huit jusqu’aux abords du Sahara. Virée bien peu traditionnelle, pour le coup, mais érudite et sensible : l’on y rencontre entre autres les Sun City Girls des frères Bishop, l’oudiste Driss El Maloumi ou encore Amal Saha, l’un des musiciens de Marrakech repérés par le label Sublime Frequencies sur sa compilation Ecstatic Music Of The Jemaa El Fna. Sur les tables, les CD circulent au milieu des mets. Dans le livret de celui d’Ahmed Essyad – compositeur dont Yan diffuse au même moment une pièce pour soprano, violoncelle et contrebasse de toute beauté – je tombe sur ces mots : « La musique est vocale, autrement elle n’existe pas. »
~ ÉPISODE CINQ.TROIS :
« Azimut, toutes ! », Bayonne, Peña Haiz’egoa, 5, 7 et 8 décembre.
De l’autre côté de l’écran (des dénominations).
Me suivez-vous toujours ?
Pour cause de colloque à la Philharmonie de Paris (sur un thème passionnant, et complètement de circonstance : « Choisir la musique » – ou j’aurai tout appris ou quasi sur la manière qu’ont les algorithmes d’influencer notre écoute de la musique, et sur les concepts d’echoness, de neuromedia ou de prosumers), je n’arrivai que le 7 décembre en gare de Bayonne. Trop tard pour assister au concert solo de la percussionniste Camille Emaille, donné l’avant-veille – mais la captivante performance que j’avais pu visionner sur Dailymotion, captée dans le cadre d’A l’improviste pour France Musique ( lien ) m’a paru tout à fait en phase avec les superlatifs que j’ai entendus à son sujet. Suffisamment tôt, toutefois, pour prendre pleinement part aux deux dernières soirées composant le bouquet final de cette année musicale 2018 selon Einstein On The Beach. Une fête à laquelle les collègues de l’association Bastringue, Mélanie Vinolo et Iban Regnier, ont pris une part décisive – on en reparlera bientôt. Deux soli, un trio et un duo – l’ensemble, à écrasante majorité féminine, justifiant le titre générique de ces agapes : « Azimut, toute ! »
Il me faut d’abord traverser successivement l’Adour et la Nive pour gagner le rempart de la Porte d’Espagne, à l’ombre duquel (mais il n’y a pas d’ombre, c’est déjà la nuit) se niche la Peña Haiz’egoa. D’ordinaire QG du choeur d’hommes du même nom, qui l’a chevaleresquement prêté à nos non moins chevaleresques hôtes du moment, cette cave voûtée est déjà pleine, lorsque j’arrive, d’une ambiance chaleureuse dans laquelle l’habitué des concerts EOTB ne se sent nullement dépaysé, bien au contraire. (Et on ne vous dit rien du sublime maigre aux oignons, aux légumes et aux herbes – aneth ? cerfeuil ? – dont Mélanie, tard dans la nuit, régalera les présents privilégiés, une fois les concerts terminés.)
J’échange quelques mots avec Prune Bécheau et c’est en lui parlant que je réalise soudain que dans ma précédente chronique (voir « Ecrire dessus #4 » ), j’ai réussi à ne jamais citer le nom du Urs Graf Consort, le quatuor dont elle fait partie, alors même que j’en avais alors au Teatro la moitié (Adrien Bardi Bienenstock et elle, en l’occurrence avec Joel Grip et Simon Sieger) sous les yeux – et surtout qu’Adrien m’avait fait rêver en me racontant, à l’entracte, l’histoire d’Urs Graf, « dessinateur, graveur et mercenaire suisse de la Renaissance, né vers 1485 à Soleure et mors vers 1528-1529. Produisant principalement des gravures sur bois, il est l’auteur des plus vieilles eaux-fortes formellement datées et est crédité de la paternité de la technique de taille blanche » (là, c’est Wikipedia que je cite). Voilà l’oubli réparé.
Mais voilà aussi que Prune est sur scène (ou plutôt face au public, car en ce lieu, de scène, point), son violon baroque à la main, qu’autour d’elle le silence s’est fait.
Ça chuinte et ça chante, ça crisse et ça grince : durant l’introduction bruitiste de son concert semblent naître de son violon comme des interférences, des ondes radiophoniques : elle presse de plus en plus fort sur son archet, et ce sont à présent les stridences d’un archaïque télécopieur, des gémissements de pneu sur l’asphalte. On commence à percevoir des notes, comme une sorte de Caprice de Paganini enfanté par le bruit. En haut des marches, trouant le silence, des fillettes rigolent… et puis s’en vont. Ce sont à présent des braiements, ou peut-être les grincements d’une portes dont les gonds rouillés battraient dans le vent. Je pense Tony Conrad, je pense sonnailles de cornemuses, je pense drones, minimalisme, radicalité. C’est lentement que les notes semblent prendre corps, presque palpables, concrètes. Avec toujours, au premier plan, le rythme. Une fois encore je me dis : il faudrait que le public de l’Ensemble Intercontemporain, par exemple, ait la chance d’entendre ça. Je pense à l’Afrique, à des milliers d’autres folklores, et je comprends mieux pourquoi Yan me parlait tout à l’heure d’Alan Lomax.
Pause.
La seconde partie débute sous un jour plus « mélodique ». Prune Bécheau, toujours presque immobile, concentrée, les yeux baissés sur son instrument, joue sur les demi-tons, les intervalles de seconde pour sculpter peu à peu une sorte de plainte exotique aux effluves moyen-orientaux. Puis, de plus en plus, le rythme et le bruit reprennent le dessus. Des percussions africaines semblent frétiller sur le cadre, danser sur le manche sans frets de l’instrument. Instrument que l’instrumentiste rudoie de plus en plus, frappant la caisse, cinglant de son archet le chevalet et le fond (la face inférieure de la caisse de résonance), se servant finalement de celui-ci (l’archet) comme d’une baguette qu’elle fait glisser vigoureusement sur les courbes de l’instrument… Magnifiques corps sonores, et saisissant concert, une fois de plus, auquel le public – fourni, enthousiaste tout au long de ces deux jours enthousiasmants – réserve des applaudissements non moins vibrants.
Le second solo – avant que les deux musiciennes de la soirée ne se retrouvent le lendemain face-à-face – est celui d’Isabelle Duthoit. Comme Catherine Jauniaux, une artiste « culte » dont j’entendais parler depuis des lustres sans l’avoir encore jamais vue ; de ces musiciens que j’affectionne et qui vont et viennent entre les cénacles « savants » (elle est par ailleurs une des clarinettistes phares de la scène dite « contemporaine ») et les scènes « improvisées » avec un égal talent. Elle se tient là, filiforme et chic dans sa robe élégamment excentrique qui lui donne des allures de fée, au centre, centrée. Nul micro ne fait écran entre elle et nous.
Décidément – c’est ce que je me dis, d’abord – les concerts d’Einstein On the Beach n’invitent pas seulement à être curieux, ils incitent aussi chacun à se faire poète – mais aussi botaniste ou géologue. Les mots manquent pour définir ce que l’on entend, pour décrire les différences élémentaires, impalpables mais évidentes, qui séparent et unissent toutes ces voix incroyables que j’ai pu découvrir depuis le début de la saison – celles de Pantxix Bidart, de Claire Bergerault & Fred Jouanlong, de Catherine Jauniaux, de Natacha Muslera ; celle à présent qui s’échappe de…
Mais d’où s’échappe-t-elle exactement ? Est-ce du ventre, de la gorge ? Est-il possible que des cordes vocales puissent produire pareils sons, qu’un corps soit capable d’émettre une si surhumaine raucité – et ce, sans la moindre amplification ? On croyait avoir tout entendu avec les chanteurs susmentionnés, mais non : Isabelle Duthoit parvient encore à ouvrir des horizons radicalement neufs, à déchaîner d’autres éléments. On avait entendu l’eau, on avait entendu le feu : il y a quelque chose d’à la fois minéral, terrestre et boisé dans les sons et les situations qu’elle déploie sous nos yeux, joignant le geste à la non-parole – à ce moment-là je suis sur le côté de la scène, je la regarde de profil et il me semble voir de la danse autant que de la calligraphie ou du théâtre japonais. C’est un feu d’artifice vocal ininterrompu toujours assujetti à un souffle tellurique, profond, unique maître d’œuvre de la dramaturgie, qui vous prend littéralement aux tripes. Emerveillent aussi cette maîtrise, ce total contrôle des moyens vocaux, cette discipline quasi orientale : Isabelle Duthoit semble capable de tout faire, présence surnaturelle et profondément naturelle. Son concert laisse sans voix un public qui semble n’avoir cessé de respirer avec elle.
Le lendemain soir… je n’ai pas pris une seule note. J’avais envie de poser mon crayon et laisser mes oreilles libres de suivre où bon leur semblait les musiciennes de la soirée – les musiciens, pardon, il est vrai que l’irremplaçable Monsieur Gadou était là, unique (mais ô combien valeureux) représentant de la gent masculine sur la non-scène de l’Haiz’egoa ces soirs-là. De ne pas perdre le fil ni diluer mon attention, bref, de profiter du spectacle.
J’ai été emballé par le duo entre Prune Bécheau & Isabelle Duthoit, cette fois à la clarinette. Mais qu’ajouter à ce que j’ai déjà dit précédemment, quand on saura que cette dernière manie l’instrument avec la même virtuosité, la même nécessité et la même expressivité qu’elle module sa voix ? Les émotions sont de même nature, ce constant et intense mélange de surprise et de beauté. Comme avec Anorak (C. Jauniaux & N. Muslera), je me souviens avoir observé avec fascination la manière dont le vocabulaire des artistes varie entre le solo et le duo : la façon radicalement différente dont Prune Bécheau, ici, sollicite certains des éléments de langages qu’elle avait exposés la veille dans son solo, les tord ou en avance de nouveaux… L’une et l’autre sont passionnantes à regarder, comme mues par une entente instinctive de l’ordre du zen… Ecrivant cela aujourd’hui, je repense à ces mots de Chris Marker dans Le Dépays : « Tout est dans le geste du tireur. La flèche n’a pas plus de but que n’en a la vie : ce qui compte c’est la politesse envers l’arc. »
J’avais beaucoup aimé Calamité, précédent spectacle du collectif Yes Igor, emmené par Isabelle Jelen, sur les lettres de Calamity Jane à sa fille. J’étais donc curieux et même impatient de découvrir la première « étape de travail » d’Etude en rouge, nouveau projet de musique spectaculaire, en trio – avec Monsieur Gadou et l’altiste Tiziana Bertoncini –, prolongeant l’exploration du Far-West et de ses mythes à travers cette fois les poèmes et épopées recueillis dans La Partition rouge, une anthologie de textes de ces peuples que l’on dit « natifs » traduits et présentés par les écrivains Jacques Roubaud et Florence Delay, publiée en 1988. Une « source » qui est ici bien davantage à prendre au sens premier, figuré du terme : comme le lieu où sort une eau sort naturellement du sol, donnant ensuite naissance à une rivière : de fait, c’est un déferlement de sons de toute provenance (voix, guitare, violon, harmonium), de paysages de toute nature qui entraîne l’auditeur dans son sillage. Spectacle haletant et euphorisant que celui de ces musiciens qui s’escriment à faire se télescoper les climats les plus variés sur ces vastes panoramas, où les textes proférés par Isabelle Jelen ne sont plus qu’une matière, une trame musicale parmi d’autres : transe chamanique, primitive et non dénuée d’esprit(s), qui bringuebale le spectateur à travers l’Amérique de ses rêves, d’Ennio Morricone à Sonic Youth. En parfaite osmose avec leur sujet de départ, les trois musiciens livrent un spectacle singulièrement habité. Et déjà remarquablement abouti…
Il y a quelques minutes, sur Internet (j’ai des manies bizarres), je suis tombé sur ces commentaires de Philippe Albéra au sujet du compositeur Helmut Lachenmann : « Lachenmann cherche à nous faire prendre conscience de l’événement pour lui-même, du phénomène musical comme ce qui naît dans l’instant et produit un étonnement, une forme d’expression encore jamais éprouvée. Il vise une musique qui, loin des réflexes acquis, des conventions et des références, redevient une ‘expérience existentielle’, un moment où l’on découvre ce que l’on n’avait jamais imaginé auparavant tout en s’interrogeant sur sa signification. »
Cela m’a semblé être un parfait résumé des émotions que ces concerts m’ont permis de vivre, de traverser, et de maladroitement essayer de retranscrire – grâce à tous ces musiciens qui finalement, même lorsqu’ils donnent de la voix, se passent si bien de mots. Et aussi, un parfait complément aux mots de Nicolas Bouvier, dans son journal, à propos de ces musiques folkloriques qui invitent à écouter « en cherchant derrière chaque note les sentiments bruts, les motivations immédiates et sans s’embarrasser de cet écran civilisateur, de la connaissance qu’on peut avoir d’une époque, d’une culture et de ses dénominations, que l’auditeur interpose si souvent entre l’émotion qui a motivé la musique et celle qui éprouve à l’entendre. »
David Sanson