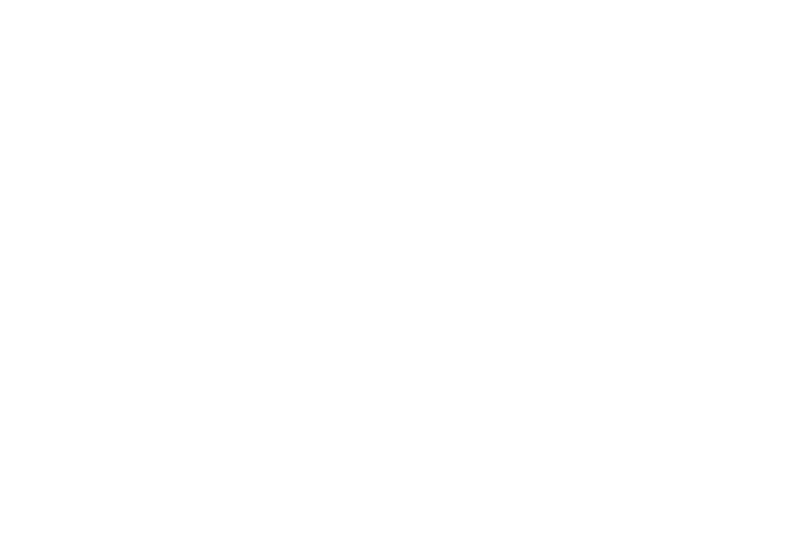ÉCRIRE DESSUS #1
PAR DAVID SANSON
SOIRÉES DES 6 & 7 SEPTEMBRE 2018
Avec Docteur Culotte / The And / Black Andalu
Sononamé / No Noise No Reduction / Taranta
Cette lumière italienne sur les murs de Saint-Michel.
«Tous les jeudis et vendredis soir, au Teatro, on déguste la gastronomie napolitaine et méditerranéenne 1/ de saison 2/ avec des produits du marché du jour 3/ selon les envies du chef 4/ comme en famille au cœur de l’Italie…» C’est drôle, avant d’arriver au Teatro et d’y lire cet avis sur un tableau, chemin faisant, fendant sur mon vélo l’asphalte humide mais flambant neuf du cours de l’Yser en ce jeudi 6 septembre, je repensais à ce que j’ai fini par appeler la «qualité italienne» de Bordeaux: sa teneur transalpine ne tient pas seulement à cette ambiance globalement méridionale qui fait que les gens ont l’air plus détendus qu’ailleurs et que les tomates ont vraiment le goût de tomates ; elle tient aussi à cette lumière qui, lorsqu’elle matche avec la teinte quasi ocre des façades ornementées, atteint à une texture et une finesse proprement miraculeuses ; également à la multiplicité des places de toute forme et de tout format qui, partout ici comme à Rome, ménagent au détour des rues de la ville comme autant de clairières avenantes ou secrètes ; elle tient encore, comme en ce début de soirée, à ces grosses pluies lourdes pareilles à celles qui obstruent certains dimanches romains, mais à l’issue desquelles l’air semble creusé, purifié, la ville, tout entière délavée et ravalée. Un temps à boire un Negroni.
Au Teatro, en arrivant vers 19 heures et en commandant un cocktail, on se sent en effet, direct, «comme en famille au cœur de l’Italie». Un étage, deux ambiances : dehors, sur le trottoir et surtout sur la rue, voire la place Maucaillou, les habitués (du lieu, des concerts Einstein On The Beach), heureux pour beaucoup d’inaugurer la rentrée en se retrouvant à l’aperitivo, palabrent à qui mieux mieux ; dedans, autour de ce coin derrière le bar que l’on ne saurait décemment appeler «scène», d’autres habitués, moins nombreux mais non moins fervents, écoutent Docteur Culotte. «J’adore ce genre d’endroits improbables», dit Yan. Et on le comprend, et on le croit volontiers.
Il ne faut pourtant pas toujours croire ce que dit Yan. A moi ainsi qu’à quelques autres, n’avait-il pas pronostiqué que le concert débuterait vers 19 heures? Or, à ce moment-là, cela fait presque 45 minutes que dure le set de ce duo à l’origine formé par Sol Hess et Jérôme d’Aviau, qui ce soir se présente en format trio et en mode quasi unplugged (n’était un clavier Microkorg branché à un mini ampli portatif posé sur le bar)… Arf. Néanmoins, comme sur disque, on a le temps d’être frappé par la puissance de la voix de Sol Hess, organe de crooner punkoïde qui évoque parfois Nick Cave, d’autres fois David Byrne, par son charisme ténébreux, et par l’énergie que parviennent à créer ensemble cette guitare acoustique, cette batterie étique et ce synthé minimaliste. Et voilà que Sol annonce la dernière chanson: «Une chanson d’amour. Courte et qui fait mal, comme les meilleures histoires d’amour.» La chanson en question, c’est Theodore, morceau effectivement bref qui est l’un des 7 composant du très réussi Olga (https://docteurculotte.bandcamp.com), 25 cm (mensuration de rêve pour un vinyle) publié voilà 4 ans et demi par Catulle & Ramón. En conclusion de son set, les musiciens de Docteur Culotte en livrent une version littéralement endiablée, avant que de s’égayer parmi l’assistance.
Cette lueur mélancolique dans le regard des vieux punks.
Durant la pause, on reprend les conversations interrompues voici quelques minutes ou quelques mois. On attrape quelques aphorismes à la volée («C’est dur, de gagner de l’argent avec son art »). J’écoute longuement Monsieur Gadou me parler, avec des étincelles dans la voix, du duo «magique» qu’il forme avec le chanteur basque Pantxix Bidart, duo qui sera d’ailleurs à l’honneur, le 25 septembre, du premier de la nouvelle série des «Mardis au Zinc Pierre» organisée par Einstein On The Beach. Et puis voilà que le spectacle recommence, des sons de guitare et d’ampli annoncent l’imminence de The And (https://gwsok.bandcamp.com/album/the-and). Je me fraye un chemin parmi la foule relative, réussis à trouver une place sur la banquette à côté de Sarah la photographe, pile face à Nicolas Lafourest et G.W. Sok, et j’ouvre les oreilles.
Ou plutôt, d’abord, les yeux. Impressions visuelles en premier lieu.
Il y a le regard de G.W. Sok, qui fut le parolier et le chanteur de The Ex, légendaire groupe punk batave: j’y trouve une lueur à la fois mélancolique et magnétique, désabusée et en même temps vive, comme une colère qui, tout au fond, n’aurait jamais fini de s’éteindre – j’y retrouve ce lumineux mélange de sagesse et de révolte que j’ai déjà pu percevoir dans les yeux de plusieurs musiciens ayant vécu le punk que j’ai eu le plaisir de côtoyer : Penny Rimbaud (Crass), Colin Newman (Wire), Ronald Lippok surtout (Ornament & Verbrechen), auquel me fait parfois penser G.W. Sok, sa présence à la fois nonchalante et nerveuse, élégante et morveuse. Il y a aussi le blond platine des cheveux de Nicolas Lafourest, silhouette fuligineuse et quasi féminine, et le blanc patiné de ceux de son aîné.
Tous deux sembleront, durant tout le concert, comme adossés à une même gigantesque colonne invisible. Debout les pieds fichés, ancrés dans le sol, les jambes et le haut de leur corps doucement mobiles, droits comme des blés à peine courbés par le vent, ils se livreront pendant une petite heure à un sur-place envoûtant et très chorégraphique, le guitariste, très légèrement en retrait, semblant parfois soutenir le chanteur sans le toucher, par la seule force invisible, la seule grâce de son instrument. The And : Le Et ?
Le premier morceau qu’ils joueront s’intitule Heart, et c’est bien de cela qu’il s’agit : de cœur, de courage ; de lien. Ces arpèges métalliques, percussifs, le son de guitare urbain, quasi industriel de Nicolas Lafourest commencent inévitablement par en rappeler d’autres au critique musical blasé, celui qui ne cesse de courir après une hypothétique virginité auriculaire, et qui se demande en cet instant s’il ne faudrait pas contextualiser un peu, expliquer par exemple aux plus jeunes ou aux plus ingénus d’entre les lecteurs qui était The Ex, quel place ce groupe occupe dans l’histoire de la musique. Mais très vite on n’y pense plus, je me laisse emporter par la puissance hypnotique de la musique et des mots. Sobre et pourtant extrêmement varié, à la fois massif et tout en subtilité(s), le jeu de Lafourest n’use des boucles que de manière judicieusement parcimonieuse : jamais il n’oublie de ménager les espaces permettant à la voix, rauque et vigoureuse, de se déployer, comme à travers une caisse de résonance. On se dit que rarement on a entendu la langue flamande sonner de manière aussi douce. On se demande si cette longue litanie que G.W. Sok déroule à partir de la répétition du mot «Holy» correspond au poème éponyme d’Allen Ginsberg (celui-là même dont Jacques Doyen et Jac Berrocal livrèrent jadis (1983) une mémorable version francophone (https://www.youtube.com/watch?v=VZ8gK94OMEM), rééditée récemment en face B de Fuel 217 (https://www.discogs.com/fr/Anne-Gillis-Jac-Berrocal-Jacques-Doyen-Fuel-217-Sacr%C3%A9/release/12270493), morceau d’Anne Gillis et Jac Berrocal qui vient de paraître, sous forme de 45 tours picture disc, sur le label Présence Capitale D’Avantage dirigé par André Lombardo). On s’éloigne de quelques mètres pour changer la perspective, le point d’ouïe ; vu du comptoir, le Teatro à cette heure a pris des airs berlinois. On songe à Fugazi en écoutant certaines des complexes constructions échafaudées par Nicolas Lafourest. On se dit, en entend le même reprendre les accords et la mélodie d’Atmosphere de Joy Division, que ce concert a parfois des allures de voyage à travers la mémoire. On songe une fois de plus à cette phrase si juste de Philippe Lançon: «Le rock, c’est quand les souvenirs sont devant soi.»
Et puis, parce qu’on sait par expérience qu’il devient difficile d’écrire sur la musique à partir d’un certain point, je veux dire d’écouter la musique sereinement (sinon objectivement) en sachant qu’on va devoir écrire dessus, on pose définitivement ce stylo et ce carnet, et on se laisse emporter par tout ça.
Extases et stase.
Le lendemain à l’heure du thé, c’est un rectangle d’azur immaculé qui plafonne la cour du Centre d’animation Saint-Pierre. Des tables sont dressées pour accueillir le pique-nique de rentrée qui est aussi celui du quartier, dans un coin de la cour, sous la voûte azurée, devant un mur sur lequel les enfants du centre ont peint une carte du monde peuplée de leurs prénoms, des transats s’éparpillent face à une scène formée d’un tapis posé à même le sol. Sur celui-ci, un harmonium indien, une viole de gambe et un amas de percussions diverses et variées : le singulier set-up du trio Sononamé, dont le concert débute à la manière d’un râga indien, par un long drone d’harmonium sur lequel la viole d’Eric Camara vient déposer comme autant de striures. Ce qui émerveille d’abord, c’est l’osmose entre les timbres de ces deux instruments qui pourtant ressortissent à deux traditions radicalement différentes : la texture de la viole de gambe, délicate, semble se glisser entre les notes de l’harmonium de Stéphane Torré-Truéba suivant une technique qui évoquerait presque le tissage, venant instiller de la matière et de la lumière à la trame sonore, en faire ressortir et miroiter les harmoniques. De fait, la densité sonore à laquelle parviennent ces trois musiciens est surprenante : la voix de Stéphane Torré-Truéba, dont le chant fait souvent songer au khöömii mongol, coasse, croasse, crisse, grince, chuinte, mugit ou simplement psalmodie, ajoutant sa ligne au tissu d’ensemble. Quant aux percussions de Yohan Loiseau – maracas, castagnettes, cymbales chinoises, claves ou cloches –, elles apportent à l’ensemble une dimension supplémentaire, installent une sensation de relief et d’espace, conférant sa dramaturgie à cette musique de la stase dont on sort comme d’un rêve. Après ce thé extatique, il me faut m’éclipser pour aller reconduire ma fille à la maison : je ne verrai que la fin du set de No Noise No Reduction, autre trio singulier, mais saxophonique celui-ci (deux saxophones basses et un baryton!). Ne me restera qu’à me consoler en lisant, à la maison, les commentaires et comptes rendus publiés sur Facebook: «Un des meilleurs concerts [de NNNR, Ndlr. ] que votre humble narrateur ait eu le plaisir de recevoir. Des versions très lâchées, beaucoup d’improvisations toujours hyper justes…» (Manu Muré, tourneur du trio); un concert à l’«énergie un peu punk», sans «aucun artifice, ni pédale d’effet, ni amplification, seulement la relation entre l’artiste et son instrument » (Steph Anelive). De fait, lorsque je suis de retour rue du Mulet, celle-ci vibre de scansions des plus euphorisantes : les tables du pique-nique se sont remplies d’une joyeuse affluence, et devant la scène, le public clairsemé mais attentif, jusqu’à certains riverains assis sur le rebord de leurs fenêtres, est dominé par une poignée de fillettes en folie. A la fois cocasses et puissants, Marc Démereau – encore un échappé de Cannibales & Vahinés, collectif où ont également évolué Nicolas Lafourest et G.W. Sok –, Marc Maffiolo et Florian Nastorg s’escriment comme des beaux diables sur leurs instruments et font souffler un vent libertaire sur la cour du Centre Saint-Pierre. Un peu punk, pour le moins, mais carrément maîtrisé. Aux fillettes en folie qui réclament «une chanson, une chanson », Marc Démereau finira par livrer une reprise de Brigitte Fontaine: Où vas-tu petit garçon (https://www.youtube.com/watch?v=svKehQSpXbw), interprété au mégaphone, met tout le monde d’accord.
Retour en Italie.
Après le thé puis l’apéritif, le concert de l’après-dîner marquera un nouveau changement radical d’ambiance et d’horizon. Avec son projet Taranta, Mari Lanera, charismatique Italienne est l’une des figures de la scène underground bordelaise, option cold wave/disco-punk (Pschpshit, LDLF, Las Felindras, Docteur Culotte, Zero Branco…), amorce un retour vers les musiques de son pays d’origine, et plus particulièrement vers la tarentelle. Cette danse d’Italie du Sud était, à l’origine, un rite de désenvoûtement sur les personnes que l’on disait mordues par une araignée) la tarentule et qu’il s’agissait de faire danser des heures durant, jusqu’à épuisement. Retour vers le futur, revisitation que Mari Lanera aborde, un loup enluminé lui masquant le visage, avec pour seules armes un laptop et son clavier maître – eux-mêmes recouverts d’un tissu pailleté d’or et serti de la photo en noir et blanc de ce que l’on se figure être une sainte quelconque (je n’ai pas vérifié cette information, et cette impression tout à fait floue), si tant est qu’une sainte puisse être quelconque –, et surtout sa voix grave et langoureuse, suave et rugueuse, de diva new-wave. Mais aussi, ce soir, avec l’aide d’un «invité surprise» de choix: le joueur de tablas Niraj Singh. Etrangement (c’est l’adverbe qui convient), cette rencontre entre les airs populaires des Apulies ou de la baie de Naples et la musique indienne semble tomber sous le sens : les percussions accusent les ruptures de rythme des transes transalpines, en maximisent la puissance hypnotique, elles les emportent vers un indéfinissable ailleurs, un folklore imaginaire teinté des obscurs accents d’une new wave de cabaret burlesque : on a parfois en effet le sentiment d’assister à la rencontre de Tuxedomoon (ou Mattias Aguayo?) et Talvin Singh,entre théâtralité et abandon, distance et immédiateté – un fil sur lequel Mari Lanera avance avec une ingénuité d’autant plus troublante qu’elle est peut-être feinte.
La nuit est déjà avancée, l’état des convives aussi quand El Señor Yan Beigbeder revêt son plus bel habit de sélectionneur andalou pour faire guincher le public du Centre Saint-Pierre, ambianceur au sens premier, le plus noble, du terme, et clôturer dignement (?) une rentrée musicale placée sous le signe d’un éclectisme du meilleur aloi. De ces musiques libres, sinon vierges, du moins non profanées, de celles qui savent désarçonner le critique chevronné et lui donnent le sentiment, d’autant plus galvanisant qu’il est éphémère, de pouvoir vivre une expérience un peu profane.
A suivre.
David Sanson