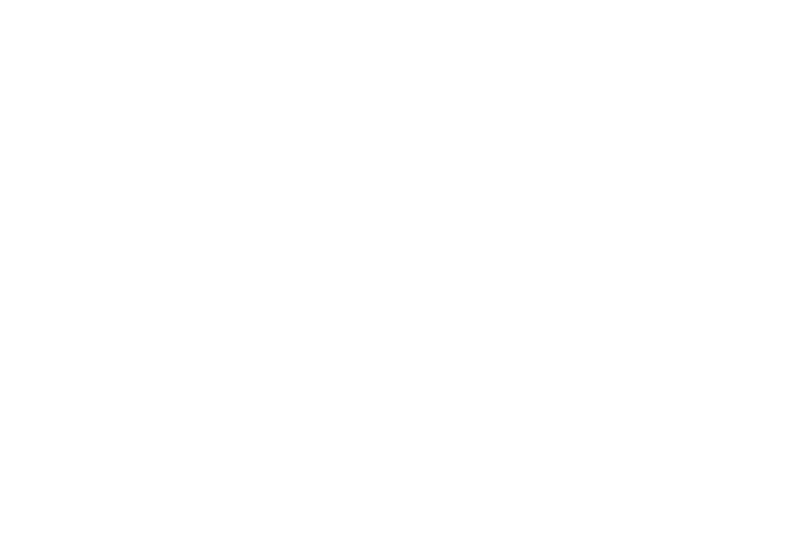ÉCRIRE DESSUS #9
PAR DAVID SANSON
29 juin 2019 – Les belles goulées
3 juillet 2019 – Le chant des lucioles
IX.1
29 juin 2019 : Jérôme Noetinger et Benoît Kilian à Langoiran, aux Chantiers navals Tramasset, dans le cadre des Belles Goulées.
Alors cette fois, ça se passe à Langoiran. À défaut d’avoir pu (re)voir Parlophonie, la magnifique performance radiophonique d’Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache présentée le 15 juin dans le cadre du festival Chahuts (❤) ; à défaut d’avoir pu assister au duo entre l’auteure Elsa Gribinski et le batteur Mathias Pontevia inaugurant le cycle « Les Mots ont du son », la semaine précédente au bar de la Halle des Douves, voilà que j’arrive, le 29 juin, à une trentaine de kilomètres au sud de Bordeaux, sur les berges de la Garonne, dans ces Chantiers navals Tramasset que j’avais depuis longtemps envie de découvrir. C’est là en effet que se tient la deuxième édition des Belles Goulées, « fête des vins bios, biodynamiques et naturels en Entre-deux-Mers » à laquelle Einstein On The Beach est venu apporter un contrepoint sonore.
Loin de la canicule bordelaise, la brise rend pleinement opérante cette magnifique fin d’après-midi estivale, fin d’après-midi qui commence par une visite des lieux en compagnie de la danseuse et chorégraphe Laure Terrier – Langoironnaise d’adoption qui se trouve être l’instigatrice de ce rapprochement entre artisans/expérimentateurs du sol et du son – et de Paul Dupouy, l’un des activistes qui contribuent à faire de ces Chantiers une magnifique entreprise de construction collective, à tous les sens du mot. Après les ateliers, tous deux m’emmènent jusqu’au « carrelet » fraîchement achevé : surplombant l’eau, une cabane de bois sur pilotis destinée non pas à la pêche au carrelet, mais à l’accueil d’artistes en résidence, qui laisse rêveur…
Délaissant la contemplation des ondes, du jeu irisé des rayons et des remous, avant d’en venir au fait, je m’en retourne bientôt sous la halle abritant les « exposants » des Belles Goulées, histoire d’en savourer quelques-unes, de belles goulées, en attendant le concert du soir. D’autant que l’un des deux protagonistes de celui-ci fait justement partie de ceux-là : Benoît Kilian, le percussionniste polymorphe avec lequel doit se produire Jérôme Noetinger – hôte d’honneur des trois concerts proposés durant ce week-end (je n’en aurai pu voir qu’un seul) –, lorsqu’il ne joue pas au sein de La Générale d’Expérimentation, est en effet viticulteur « naturel » en herbe dans sa Côte d’Or d’origine. Et en attendant de retrouver ses « fûts », il se tient pour l’heure derrière un alignement de bouteilles, sa première toute première cuvée, que Yan (Beigbeder, alias El Selector Andaluz) et David (Chiesa) m’enjoignent de goûter : La Ripopée, deux tiers pinot noir, un tiers chardonnay et melon de Bourgogne. Bilan de ce premier arrêt au stand : un brelan de bouteilles que je mets de côté avant d’aller me poster lentement – non sans m’être au passage délecté de quelques étonnantes perles liquoreuses plus locales, en provenance directe du sauternais voisin – dans la salle, presque entièrement de bois dévêtue, où va se produire le duo.
Après le concert, autour de l’une desdites bouteilles désormais débouchée – et après avoir commencé mon dîner en compagnie de gens que je ne connaissais ni d’Ève, ni d’Adam avant de mettre le pied ici – et que je n’aurai sans doute jamais pu croiser ailleurs (et c’est bien l’un des charmes des soirées Einstein On The Beach que de favoriser ce genre de rencontres) –, je ferai enfin la connaissance de Jérôme Noetinger en chair et en os. Il faut parfois attendre longtemps avant que certains chemins finissent par se croiser, après avoir si souvent sinué l’un vers l’autre. Par le passé, lui coiffé de sa casquette Revue & Corrigée, moi de mon galurin Octopus/Mouvement, nous avions pu avoir quelques échanges suivis, parfois salés, par courrier électronique interposé. Dialogue parfois de sourds, mais de sourds souriants, échanges toujours à fleurets mouchetés autour de positions sur lesquelles lui et moi campions respectivement avec d’autant plus d’assurance que sans doute nous sentions que ces positions n’étaient pas inconciliables, toutes deux situées du bon côté de la barrière finalement. Ce soir-là, il m’a semblé brièvement sentir chez lui de la surprise lorsque je me suis présenté, mais une surprise joyeuse, sans aucune réserve, et j’étais tout aussi enchanté, et nous avons ensuite partagé le vin et le couvert autour d’une de ces tablées comme on les aime, à parler de tous ces sujets passionnants, triviaux ou érudits, que la musique excelle à faire fuser.
C’était d’ailleurs le but de ces concerts-dégustations que de faire découvrir des démarches somme toute similaires, qu’anime une même volonté de création et d’expérimentation, dans la composition desquelles entre une dose comparable d’improvisation et de savoir-faire, un même rapport direct aux éléments et aux matières. Les sortes de concerts-conférences que Jérôme Noetinger propose de temps à autre n’ont ainsi d’autre but que de montrer à quel point « vins d’auteur » et « musiques libres » partagent in fine une philosophie commune.
On ne saurait dire si les mélomanes et les œnophiles ont goûté avec un même enthousiasme les productions de cette soirée, combien les papilles des uns et les tympans des autres (et vice versa) ont pu vibrer au même diapason.
Je ne me rappelle plus moi-même exactement de ce que j’ai entendu, seulement la sensation à la fois vague et nette d’avoir été tenu en haleine – aussi avinée fût-elle, mais je suis resté plutôt sobre – d’un bout à l’autre. Le carnet que j’ai heureusement fini par retrouver avoir l’avoir bien cru égaré sur la route des vacances, voué à la fossilisation sous quelque meuble du Finistère ou du Berry, est une salutaire béquille à la mémoire défaillante du chroniqueur. Je vois qu’il y est question d’un prologue à base de grosse caisse : celle dont joue Benoît Kilian était énorme, énorme et « préparée », disposée presque à l’horizontale, et pourvue sur son pourtour ou à même la peau de tout un tas d’accessoires, appareils, instruments ou d’objet dont je n’arrive pas toujours à relire le nom, tels que des blocs de polystyrène, des aimants, de petites cymbales, ou encore ces ressorts avec lesquels il joue présentement tandis que Jérôme Noetinger reprendre et retraite en direct, au moyen de micro-contacts reliant sa table de mixage à l’instrument, ces matières sonores déjà tout à fait fantasmagoriques. Puis je vois le même homme qui, quelques instants plus tôt, me faisait goûter ses pinards, empoigner sa trompette et la plaquer sur la peau, le son se déploie à mesure qu’en arrière-plan une pulsation douce et délicatement saturée nous mène peu à peu vers des rivages plus bruitistes. Crissements, saturation, polystyrène Vs. multiphonie. Contraste saisissant entre Jérôme, tout en appareils (radio, Revox, table de mix) et Benoît qui fait feu de tous les objets en usant de sa grosse caisse comme d’un amplificateur, chacun, en somme muni de sa propre caisse de résonance ; entre le « cinéma pour l’oreille » (pour reprendre le titre d’une fameuse série de mini-CD de musique concrète initiée jadis par Metamkine, le mythique label de Jérôme) qui s’engouffre dans nos tympans et le spectacle qui se joue sous nos yeux…
… toute la difficulté étant de parvenir à passer d’une de ces dimensions à l’autre sans altérer fatalement l’écoute. De réussir à oublier de regarder ce qui produit le son, de ne pas se laisser distraire par le spectacle si étonnant pourtant de cette balle de golf que Benoît laisse rebondir sur la peau de la grosse caisse, percuter bols ou boîtes, cymbales et objets. De s’abandonner à la beauté du son. À moins que cela ne soit pas le plus important ?
Viennent de long drones, provenant probablement d’un appareil dissimulé sous la peau, nouant avec le Revox de Jérôme un duo hypnotique, la bande magnétique enroulée d’un pied de micro produisant un son qui semble celui d’une voix, d’un organe fantôme, extra-terrestre. Chant du Revox. Beauté du son d’une cymbale frottée sur une peau puis traitée en direct, de cette texture de cloche lointaine qui semble laisser ce développer un goût et un parfum, à la manière de ces vins que l’on vient de goûter. Chimie, alchimie, osmose, concentration et légèreté.
Selon le Littré, une « ripopée » est un « terme familier et de mépris » désignant le « mélange que les cabaretiers font des différents restes de vin ». Et le site Internet du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales de donner en guise d’exemple métaphorique cette phrase de Huysmans, tiré de ses Foules lourdes de 1906 : « En fait de nutriment et de breuvage artistiques, on ne lui sert [au peuple] sous couvert de religion, que de la ratatouille de cantine et de la ripopée. » Ce soir-là, on était en compagnie d’individus qui professent exactement l’inverse, qui ont une aussi haute idée de l’art que des gens – haute et modeste tout à la fois.
IX. 2 : Épilogue
3 juillet 2019 : « Le chant des lucioles » au Jardin Botanique de Bordeaux, dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019
On avait fini sur Huysmans, commençons donc sur Pasolini. Comment en effet ne pas penser à lui à la lecture du titre de cette soirée, « Le Chant des Lucioles », et à ce fameux article qu’il publia dans le Corriere della Sera le 1er février 1975, neuf mois avant sa mort ? Intitulé « Le vide du pouvoir en Italie », dit également « L’article des lucioles », ce texte, rappelons-le, met en parallèle la disparition des lucioles, vaincues par la pollution au début des années 1960, et l’irrépressible ascension de ce que le philosophe et écrivain Jean-Paul Curnier appelait le « totalitarisme marchand », qui est selon Pasolini bien plus effrayant, plus aliénant que le fascisme. L’avènement, en somme, de l’ère « de la ratatouille de cantine et de la ripopée »… Mais on ne s’étendra pas ici sur l’état du monde, on ne serait pas couché autrement – préférons-lui les pelouses du Jardin Botanique, vertes à mourir et si grasses et si fraîches en ce commencement d’été. Et à Pasolini, on préférera le parrainage de Georges Perec pour évoquer cette soirée durant laquelle je n’ai quasiment pas pris une note.
Je me souviens d’abord m’être dit, en poussant métaphoriquement les grilles de ce merveilleux Jardin Botanique, que j’étais content pour Yan et David que les conditions météorologiques fussent ce soir-là si idéalement réunies, après tout le travail que leur avait demandé l’organisation de cette « nuit » réunissant leurs propositions respectives – « Une nuit sans lune » (proposé par Einstein On The Beach) et « L’Usage du sonore » (proposé par le UN Ensemble) –, une nuit de noces barbares en quelque sorte, utopique et généreuse, célébrant les lucioles sous une voûte merveilleusement étoilée.
Je me souviens de ce jardin peu à peu gagné par le crépuscule, ce merveilleux jardin que cette période l’année pare de ses plus beaux atours, partout des plantes opulentes, une nature plantureuse.
Je me souviens de ces lueurs orangées qui semblaient rendre plus vivante la sensation de la brise tempérant miraculeusement la chaleur, je me souviens des bassins de béton stagnant en enfilade, du reflet inversé des ramures et des frondaisons dans leur eau violacée par le soir, dans la contemplation de laquelle je me régénérai en m’abîmant.
Je me souviens du soleil clinquant entre deux nénuphars sur les eaux du bassin principal, au pied du gigantesque et rougeoyant Pot 815 de Jean-Pierre Raynaud installé pour l’été par le CAPC, des silhouettes et des sons qui se déployaient tout autour, les membres du UN Ensemble installant peu à peu une chorégraphie sonore que je n’aurai saisie que par bribes.
Je me souviens par exemple de ce moment où je me suis approché de David pour le saluer et le questionner sur la provenance des sons magnifiques, atmosphériques et concrets à la fois, qui métamorphosaient présentement cet endroit du Jardin en une espèce d’œuvre de Land Art ambient, évolutive et incarnée, et où j’ai entendu sa réponse résonner dans les haut-parleurs – je n’avais pas compris qu’il était en train de jouer, je n’avais pas vu sa main promenant son téléphone sur les cordes de sa contrebasse, et j’étais tellement confus de l’avoir dérangé en un tel moment que je n’ai même plus trop cherché à comprendre comment on pouvait produire un son pareil.
Je me souviens des cannes lumineuses lo-tech distribuées aux spectateurs, concoctées par Christophe Cardoen avec l’aide des enfants du Centre d’animation Saint-Pierre, solides bâtons sertis de menues ampoules, à la fois boussoles et lucioles, que je n’aurai cessé de faire clignoter à mon gré durant toute la soirée.
Je me souviens des doux duos de la percussionniste Camille Emaille et du chanteur et luthiste Babak Rajabi, ressuscitant les « minarets mouvants » et les lumières d’Ispahan, et à travers eux les traditions poétiques immémoriales de la Perse et de l’Iran, mais aussi mixant les traditions et les époques, Babak Rajabi allant même jusqu’à interpréter quelques standards de la chanson française en mode persan, sous les regards ravis d’une assistance elle-même singulièrement mélangée.
Je me souviens de la serre du Jardin Botanique, de la touffeur de ses arbres et de ses palmiers, que la scénographie lumineuse de Christophe Cardoen transformait en une forêt enchanteresse, comme d’un rêve éveillé.
Je me souviens avoir croisé bon nombre de visages connus et de figures souriantes, de ce calme général, mais pour ainsi dire créatif, qui s’était emparé de l’assistance.
Je me souviens de La Moïra, la création de Lionel Marchetti (fruit d’un travail d’un an en collaboration avec le Centre d’animation Saint-Pierre), de ces matières sonores en perpétuelle fusion, perpétuellement mouvante, de ces vagues de son titanesques et en même temps merveilleusement précises, limpides, du choc de toutes ces textures, concrètes ou purement électroniques, abstraites et puissamment narratives, immatérielles à force d’avoir été travaillées, tantôt épiques et symphoniques, tantôt ténues et grenues, tout cela provenant de partout, ou plutôt des dizaines de haut-parleurs répartis comme autant de fleurs sur la pelouse où je gisais.
Je me souviens des étoiles qui me regardaient de haut.
Je me souviens de Lionel Marchetti expliquant, après son concert, que sa pièce n’était pas encore achevée, qu’il lui fallait encore polir certaines choses, revoir certains passages, et mille autres choses encore intarissable et passionnant.
Je me souviens m’être dit qu’une nouvelle fois, il ne me serait pas facile d’écrire sur tout cela, de décrire avec justesse tout cette musique que j’avais entendue.
Je me souviens m’être dit encore – mais plus tard, durant mes vacances, en songeant à ce texte à venir – que je serais éternellement reconnaissant à Yan de m’avoir permis de clore cette chronique en décrivant un jardin dans le soir d’été.
Je me souviens m’être dit aussi, alors, que cette commande d’écriture m’avait décidément poussé dans mes retranchements (qu’aurait pensé Pérec de l’expression « zone de confort » ?), que cette immersion dans le vaste monde de ce que j’appellerai la « musique improvisée », cette musique de la présence que je connaissais si mal et qui est, je le crois réellement, l’une des plus difficiles à saisir par le langage, m’avait placé face à mes limites et mes contradictions, face à cette vanité fondamentale qu’il y a à vouloir écrire sur la musique, mais avait aussi exercé ma curiosité, titillé ce qui subsiste, bon an mal an, de mon esprit d’aventure et d’ouverture.
Et que ce dont je resterai le plus reconnaissant à Yan, en fin de compte, est de m’avoir permis de vivre tous ces vibrants moments de musique dont je me souviendrai longtemps.
David Sanson
Bordeaux, 5 septembre 2019.
©photos David Sanson