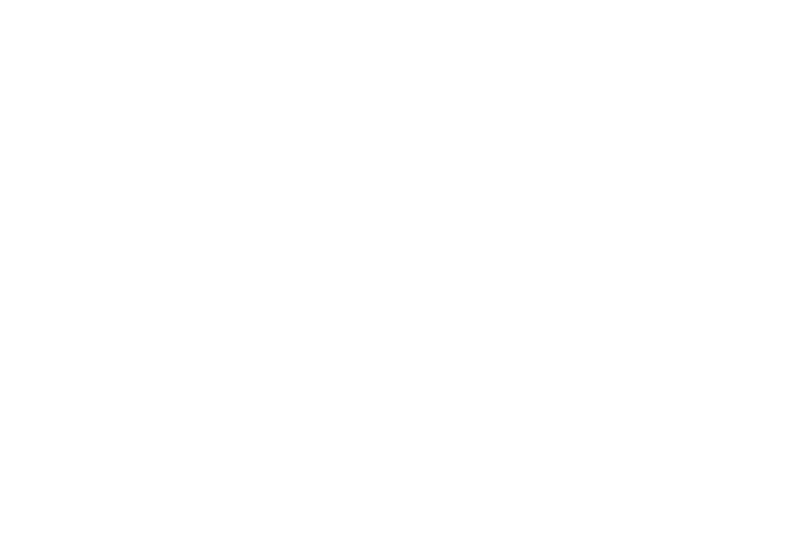ÉCRIRE DESSUS #8
PAR DAVID SANSON
Mardis au Zinc Pierre – 21 mai 2019
Centre d’animation Saint-Pierre, Bordeaux
Camille Emaille, Michel Doneda/Fabrice Charles,
Jean-Luc Guionnet/Seijiro Murayama
Décidément, il est dit que cette saison je suis appelé à rater tous les concerts de Camille Emaille et de Michel Doneda. A peine la première (que j’avais déjà manquée en décembre à Bayonne) a-t-elle eu le temps, en ouverture de ce nouveau « mardi au Zinc Pierre », de commencer à faire vibrer au moyen d’un archet une corde tendue en travers de sa table, d’en faire jaillir des sons étranges, intrigants, que mon téléphone vibre, puis m’enjoint de partir en urgence récupérer notre fille à la sortie de l’école. Le temps de pourvoir à l’intendance, et j’aurai également raté le concert du deuxième – ce soir en duo avec Fabrice Charles (fin janvier, c’est avec Lionel Marchetti que je ne l’avais pas vu).
Lorsque je regagne le Centre d’animation Saint-Pierre – non sans avoir failli juste avant m’encastrer en vélo dans un connard de cycliste freinant brutalement pour se garer sans avoir daigné faire le moindre signe pour prévenir (et ici, bien que cela me démange, je me retiens de m’épancher en un aparté sur ceux que j’ai baptisés les « bobeaufs », ces cyclistes urbains circulant au mépris du code de la route et du plus élémentaire civisme, bien plus redoutables, à l’usage, que ces automobilistes qu’ils considèrent avec la condescendance satisfaite du bobo sûr de son bon droit parce que lui, monsieur, ne pollue pas – de la « ubereatisation » de la société), l’heure est déjà au second entracte apéritif.
Mais au moins aurai-je eu le plaisir d’avoir ce soir-là, avec la percussionniste et le saxophoniste, autour d’un verre puis d’un dîner (avec cette fois aussi Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama, Fabrice Charles et tous les autres convives), des échanges passionnants, au sujet principalement de l’enseignement de la musique (ce que Camille m’a raconté de son parcours, et notamment de son passage au Mills College, m’a laissé rêveur), aussi de l’institutionnalisation d’une partie de la musique, de la différence de traitement et considération entre les scènes musicales, du sempiternel clivage séparant la musique prétendument savante des autres musiques de recherche… Tout juste tirerai-je de la bouche de Monsieur Gadou le mot de « road-movie » au sujet du deuxième concert, qui lui a donné, dit-il, « la nostalgie de l’embouchure » (Monsieur fut en effet, dans l’une de ses vies antérieures, tromboniste).
Au moins aussi le seul des trois concerts que je suis parvenu à voir aura-t-il valu son pesant d’or. C’est déjà un plaisir que de retrouver Jean-Luc Guionnet (voilà bien un musicien dont le travail devrait figurer au « répertoire » de tous les ensembles de musique contemporaine, et rayonner bien au-delà la sphère de la musique improvisée), et de le découvrir, ce soir-là, au saxophone, retrouvant lui-même son fidèle duettiste Seijiro Murayama à la caisse-claire.
C’est drôle (et rassurant en même temps) de constater combien certains concerts favorisent pour ainsi dire la transmission de pensée, combien, à l’issue de ceux-ci, il est certains mots qui s’imposent naturellement, miraculeusement, pour résumer ce que chacun a éprouvé en son for intérieur. Etait-ce à cause de Seijiro Murayama, de sa nationalité japonaise, était-ce dû au fait que Jean-Luc Guionnet, en plus d’être multi-instrumentiste, s’adonne aussi au dessin ? Toujours est-il que dans la bouche de bien des spectateurs avec lesquels j’ai parlé de ce concert comme dans la mienne, c’est le mot de « calligraphie » qui s’est imposé spontanément pour décrire cette prestation en forme de petit miracle, moment rare de concentration et de communion mêlées.
Une épiphanie, en somme, graphique dans sa configuration même. Sur leur chaises, les deux musiciens nous font face, les yeux clos que jamais ils ne rouvriront, de même que jamais non plus il ne dévieront de cette position pour se tourner l’un vers l’autre ou s’adresser quelque signe. La communication entre eux semble d’ordre télépathique. Il y a aussi le contraste entre l’or du saxophone et l’argent de la caisse-claire.
Concert graphique, surtout, dans sa forme comme dans son résultat sonore : relativement bref (et cette économie, qui tient – je ne peux résister à la facilité de l’écrire – du haïku, ne fait qu’ajouter au charme de la soirée), il consiste en une suite de séquences qui s’interrompent comme miraculeusement, ponctuées de longue plage de vide (vides qui prennent soudain une densité inouïe, comme s’ils faisaient partie de la musique, vides «cagiens»), instants musicaux qui semblent dérobés au silence comme certains idéogrammes paraissent l’être à la page blanche. Les sons eux-mêmes semblent d’une matière impalpable et pourtant presque visible: du saxophone s’échappent parfois des échos d’Afrique, à d’autres moments des sortes de loops quasi synthétiques; quant à la caisse-claire, fût-elle jouée avec des baguettes, des balais ou des mailloches, on ignorait qu’elle pût receler tant de sortilèges sonores. Je passe le concert entre fascination et hébétude, à me demander ce que je suis en train de voir, et comment je vais bien pouvoir écrire dessus. Pourtant, la musique ici est matière peut-être impalpable, mais aussi évidente. Elle est une ligne fugitive, éphémère, impermanente (et là encore il me faut convoquer la comparaison avec le dishu, cette technique de calligraphie urbaine qui se pratique depuis le début des années 1990 sur les pavés des places et des parcs chinois, dont la particularité est d’utiliser de l’eau et non de l’encre, où donc la calligraphie devient ballet de gestes et de pinceaux, traçant par terre des signes qui s’évanouissent en quelques secondes tout en semblant continuer à vivre dans notre rétine et sur le sol) – ou plutôt un dessin composé de traits et de points qui monopolise notre attention, une succession de gestes économes mais résolus, dans laquelle le timbre de la caisse-claire, fût-elle frottée ou frappée, agit bien souvent comme une sorte de sfumato. Elle (la musique, toujours) a l’évidence plastique et la densité métaphysique d’un idéogramme oriental.
De ces concerts au terme desquels on tarde à applaudir, tout plongé que l’on est dans la musique, qui cultivent l’art du dénuement et du noir et blanc (le yin, le yang) ; art faussement pauvre, infiniment riche, émanant de deux musiciens pleinement en présence, au faîte de l’instant.
David Sanson