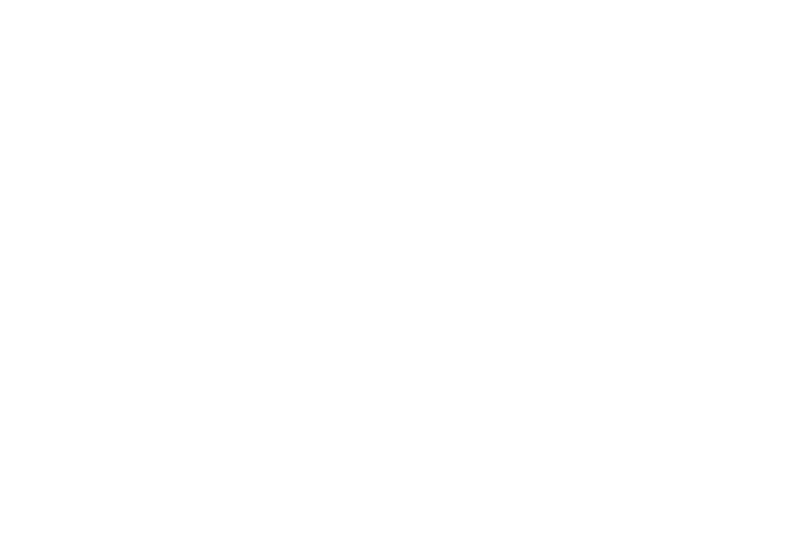ÉCRIRE DESSUS #7
PAR DAVID SANSON
Episode 7.1 – 26 mars
Julia Robin & Mood / Urs Graf Consort / Mirtha Pozzi & Pablo Cueco
Episode 7.2 – 9 avril
Odalisques / Salopes / Frédéric le Junter
Episode 7.1 (26 mars) : Julia Robin et Mood / Urs Graf Consort / Mirtha Pozzi et Pablo Cueco
Deux filles, pour commencer. Ce mardi 26 mars, derrière les vitres versicolores du Centre d’animation Saint-Pierre, ce sont Julia Robin et Mood qui ouvrent le bal, peu ou prou à l’heure du tea for two. Chanteuses et mono-instrumentistes dont c’est seulement la deuxième rencontre sur scène, l’une à la contrebasse (dont elle joue dans une multitude de formations, à commencer par le UN Ensemble), l’autre au tountoun (un tambourin à cordes béarnais, cousin du ttun-ttun basque, m’apprendront Julia Robin, puis Internet). Chanteuses aux registres, d’ailleurs, fort différents : la première se réclame de Joni Mitchell, la seconde de Meredith Monk, dont elle a suivi l’enseignement – deux visions différentes d’une musique folk grand angle. Et c’est d’ailleurs la forme d’un hommage à leur mentores (le Québécois autorise la variante féminine) respectives que va revêtir ce concert ne serait-ce qu’en cela très touchant et gracieux. Quatre filles plutôt que deux, en somme.
Julia Robin – fragile et déterminée, et toujours sur le fil de l’énergie, cramponnée à son instrument – et Maud/Mood – vocalement plus virtuose, capable d’envolées (au sens figuré comme au sens ornithologique du terme) ébouriffantes – vont ainsi de reprises en révérences, cette dernière intégrant au passage quelques chansons de son propre répertoire. Si l’écrin instrumental n’évite pas toujours les formules poncives – mais c’est seulement leur deuxième face-à-face, et dans le plus grand dénuement –, ces paysages sonores où la voix est première savent néanmoins prodiguer des instants de vraie magie… Après le concert, j’entend derrière moi quelqu’un prononcer l’expression de « trad transcendantal », je la note – mais pour ma part je suis surtout plongé dans mes souvenirs de Meredith Monk, cette femme remarquable que j’ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises (notamment pour un entretien repris sur mon blog :https://sansondavid.wordpress.com/2010/12/26/une-rencontre-avec-meredith-monk/), à Paris et jusqu’à ma bonne ville de Châteauroux (!)…
(Aparté n° 1 : Et il faut quand même que j’ajoute que quelques jours plus tard, je recevrai une réponse de Meredith à un mail que je lui avais adressé voilà plus de six mois, réponse égarée entre-temps dans les limbes numériques ; et je me dirai que certaines rencontres ne sont certainement pas fortuites, que décidément, les concerts d’Einstein On The Beach, et ce n’est pas le moindre de leurs mérites, incitent à croire aux signes.)


Julia Robin & Mood – © El Selector // Henri Cueco
Ensuite viennent les retrouvailles : avec les baladins actionnistes du Urs Graf Consort, dont j’ai déjà relaté ici un précédent et épique concert-happening (voir « Ecrire dessus #4 » –https://einsteinonthebeach.net/ecriredessus4/). Ce soir en mode trio, Prune Bécheau, Adrien Bardi Bienenstock et Simon Sieger réitèrent le miracle, et cet effet de sidération ; par la grâce conjuguée de leur incroyable engagement, de leur virtuosité brute – au sens dubuffetien du terme – et de leur bonne humeur contagieuse, ils emportent tout sur leur passage, semblant mêler dans un même mouvement l’érudition réflexive et le lâcher-prise sauvage, quelque part entre Dada et les troupes de saltimbanques du Moyen Âge… Le concert s’ouvre sur un texte lu par Adrien – extrait du roman Le Fauteuil hanté de Gaston Leroux, l’une de mes idoles d’enfance – et les événements vont ensuite s’enchaîner au rythme de ruptures de ton permanentes. Les musiciens passent d’un registre, d’une tradition et d’un instrument à l’autre avec gourmandise et une espère d’instinct presque animal (mention spéciale à Simon Sieger, capable de tenir à lui seul le tuba, le synthé et la voix dans le même morceau), les synthétiseurs apportant à l’ensemble une autre forme de choc spatio-temporel : les boucles répétitives alternent avec des slogans scandés dans la langue de Dante, les borborygmes et autres bruits de bouche, avec des chœurs homériques, les raclements rauques de violon baroque, avec des échappées minimalistes… De pop déstructurée en free-rock panique, de folk intergalactique en musique de chambre cathartique, un concert du Urs Graf Consort est une valse des étiquettes, et des épithètes. Sarabande dont on sort le cœur réjoui.
(Aparté n° 2 : Et le lendemain, nouveau clin d’œil du Destin, j’assisterai au CAPC à une projection deFlux Concert, film de Larry Miller documentant une soirée de performances Fluxus à New York en mars 1979, il y a pile 40 ans, et alors je me dirai que certaines filiations, certaines fraternités plutôt, semblent couler de source.)
Et alors, quelle joie de conclure cette soirée en compagnie de Mirtha Pozzi et Pablo Cueco ! Armés d’une panoplie de percussions de tous les continents, idiophones (la mâchoire d’âne péruvienne, ouquijada de burro, par exemple), membranophones ou condophones, qu’ils ne manquent pas de présenter à l’assistance, et d’un solide corpus de poèmes lettristes, dadaïstes et surréalistes (de Tristan Tzara à François Dufrêne, en passant par Benjamin Péret ou Gabriel Pomerand) qu’ils parviennent à faire résonner avec une (im)pertinence confondante, et souvent hilarante, ils se livrent à une joute qui frappe surtout par sa dimension osmotique : Mirtha et Pablo semblent lire si bien l’un en l’autre, être unis par une si profonde complicité que leur duo semble n’émaner que d’un seul corps, que l’on ne parvient plus à déterminer qui joue quoi, lequel des deux instruments est responsable du rythme qui nous hypnotise. Duo à la fois joyeux et sérieux, joueur et ardent, tribal et savant, dont le voyage à travers la langue semble en même temps transformer tout ce qu’il touche, mot ou son, en pur rythme.
Art pur, qui, de cadavres exquis en « calembours maraboutés », adresse du haut de son éternelle jeunesse un pied-de-nez aux musicologues de tout poil – « Ceux qui classent toutes les choses dans des étagères », Pablo Cueco dixit.
Art oratoire, optique et haptique, qui affûte la perception, aiguise l’attention autant que l’appétit, qui à la fois s’inscrit dans la lignée des diverses avant-gardes du XXe siècle (on se souvient que Pablo Cueco a, entre autres faits d’armes, enregistré Cellule 75 du grand Luc Ferrari, et l’on pense aussi à son père, le peintre et poète Henri Cueco (1929-2017), dont j’entendais naguère la voix aux Papous dans la tête, et en voulant regarder sur Internet les tableaux de celui-ci je tombe sur ce merveilleuxPaysage dans la main de 1978 que je ne peux résister au plaisir de reproduire ici) et semble n’avoir rien perdu de son ingénuité, de sa générosité ni de son actualité…
« Art osé », comme le disait ce poème de Dufrêne.


Urs Graf Consort © Sarah Dufaure


Urs Graf Consort // Mirtha Pozzi & Pablo Cueco © Sarah Dufaure


Urs Graf Consort // Mirtha Pozzi & Pablo Cueco © El Selector
Episode 7.2 (9 avril): Odalisque / Salopes / Frédéric Le junter
Et deux semaines plus tard, nous revoilà au même endroit, pour trois nouveaux concerts mêlant des musiques vocales et instrumentales dont le dénominateur commun serait le goût pour l’aventure et l’expérimentation.
J’avais déjà pu voir sur scène Odalisque, duo doublement mixte formé par Audrey Poujoula (électronique) et Jan (prononcer : Jean) Myslikovjan (accordéon) suite à leur rencontre sur les bancs du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud : c’était à l’occasion de leur brève mais intense participation à la soirée « Dossier Bordeaux 2017 », organisée le 3 février 2018 à l’Espace 29 par l’association 6click Culture pour célébrer la parution de l’excellente compilation du même nom, dédiée à la scène expérimentale bordelaise (que l’on peut écouter et acheter sur la page Bandcamp du net-label Nostalgie de la Boue –https://nostalgiedelaboue.bandcamp.com/album/dossier-bordeaux-2017). Ce 9 avril, j’arrive en retard. Le concert a commencé depuis 5 minutes, et de l’intérieur du Centre d’animation Saint-Pierre me parviennent des grondements, des sons de sirène de navires ou de soufflerie (qui elle-même pourrait provenir aussi bien d’un orgue que de quelque usine démentielle). Lorsque j’entre pour prendre place dans la salle, c’est à nouveau la même impression de désorientation qui me saisit, de perte de repère, de dépaysement : d’où provient exactement le son que j’entends ? lequel des deux instruments en présence en est à l’origine ? Quelques instants plus tard, je suis presque sûr que c’est l’accordéon qui émet ce drone infrabasse que Jan fait vibrer en agitant les doigts à quelques centimètres de son boîtier gauche – l’ordinateur se chargeant ensuite de l’accroître et l’amplifier, de l’étirer en format stéréo.
A cette heure de la journée le silence est dur à obtenir, le hall de Saint-Pierre bruisse d’incessantes allées et venues. Et pourtant c’est de ce côté-là que le duo se risque : vers un silence parcouru de bruits d’insectes et d’oiseaux dont on ne saurait dire s’ils sourdent de l’extérieur du Centre ou de l’intérieur des haut-parleurs – le souffle que l’on perçoit, est-il celui de l’air ou des enceintes ?
Puis un sifflement émerge, obsédant, qui ouvre une longue séquence plus littéralement atmosphérique, au fil de laquelle l’ordinateur semble aller son chemin, avant que l’accordéon ne commence à égrener un motif de quatre notes en ostinato, qui débouche sur des accords sur fond de cloche quasi tibétaines ; j’ai parfois du mal à me concentrer – en raison des allées et venues sus-évoquées, aussi parce que j’attends une amie qui vient finalement d’arriver – mais je me laisse envoûter par la manière dont l’accordéon s’immisce et se love dans les bruits ambiants, et la manière dont ses sonorités se trouvent mises en espace par la grâce de l’informatique. J’ai même le temps de prendre des notes (ce qui explique le présent surcroît de précision descriptive), d’écrire le nom de Future Sound Of London (dont l’album ISDN fut l’un de mes bréviaires ambient dans les années 1990), le mot « space ».
De noter encore combien l’accordéon ajoute à l’ensemble une dimension « mémorielle » – toute bribe de mélodie jouée par cet instrument-là devient instantanément une source d’évocation – qu’il s’agisse d’un tango, d’une bourrée, ou d’un drone comme celui qui commence à présent de se déployer, long accord d’accordéon indéfiniment tenu qui donne à la pièce une tonalité subitement industrielle, et une dimension presque orchestrale (je note les mots « psychédélique », « plunderphonics »)…
Je ne sais plus si c’est ainsi que s’est achevé le concert ou si le duo n’a pas fini par revenir une nouvelle fois vers le silence et le pianissimo. J’apprendrai en tout cas à l’issue de celui-ci que la pièce que l’on venait d’entendre était une nouvelle version d’Aurore mécanique, création élaborée l’hiver dernier à la faveur d’une résidence organisée par le Centre des Musiques Nomades et le festival Détours de Babel à Grenoble (que l’on peut écouter ici – https://soundcloud.com/0dalisque/aurore-mecanique?fbclid=IwAR0tB2lj6Bxg4UaT69MfuzyYe3XjQuZgJnkSP0RxupRAzx5pD3k8s8ywRqI) ;
et que les chants d’oiseaux édéniques que je percevais tout à l’heure provenaient bien des enceintes.


Frédéric Le Junter © El Selector


Odalisque // Salopes © El Selector
La jeune fille qui m’accompagne – Lou, la fille d’un couple de vieux et chers amis, étudiante à Bordeaux et baby-sitter occasionnelle de ma fille, passionnée de toutes sortes de musiques, que j’avais conviée à venir découvrir en même temps que moi les interventions de ce soir – n’a pas tellement aimé Odalisque, elle n’a pas réussi à entrer dans cette architecture sonore que je pensais pourtant accessible au profane – mais après tout, tout le monde n’a pas forcément envie d’y entrer – il est toujours malaisé d’accepter que tout le monde n’a pas le mêmes goûts que soi.
Elle a beaucoup apprécié en revanche le concert de Salopes – auquel j’aurais d’ailleurs bien aimé que ma fillette assiste, elle qui aime tant les voix, même si nombre des textes incarnés (ô combien) par Laurène Pierre Magnani étaient pour le moins, comme le disent les Américains, « explicit ». Une première mondiale, qui plus est, que ce face-à-face entre la chanteuse et l’incontournable Monsieur Gadou, rencontre intime en marge de Lord Rectangle, le groupe de calypsoul où ils œuvrent tous deux (brillamment, comme j’avais pu m’en rendre compte quelques semaines auparavant à l’occasion de leur prestation au Quartier Libre). Première mondiale que l’on espère bientôt suivie d’une deuxième, et de bien d’autres, tant le programme de ce duo fonctionne à merveille.
Le mot de « grâce » est le premier à m’être venu à l’esprit lorsque Laurène Pierre Magnani entonne la première chanson de ce récital. La pureté, la texture, la chaleur, la puissance de sa voix à la fois rauque et suave captent immédiatement l’attention, de même que la lumière qui émane de sa présence. Pieds nus et moulée dans une robe claire, on se dit que Laurène Pierre Magnani n’est pas là par hasard, même si elle se montre parfois intimidée, qu’il y a décidément des gens qui, plus que d’autres, possèdent véritablement un don, une qualité de présence unique ; et des voix, à la fois enchantées et hantées, à travers lesquelles semblent murmurer les fantômes des plus illustres chanteuses de jazz, comme dépositaires d’un trésor et d’un patrimoine sacrés.
Malgré ses lourdes boucles d’oreille d’argent, Monsieur Gadou se fait plus discret. Minimaliste est en effet l’accompagnement, canaille et distingué, qu’il prodigue à cette voix d’exception, ce qui ne l’empêche jamais de transmettre à sa complice, en tout bien tout honneur, les décharges d’énergie dont elle a besoin. Textes dont, dans mon ignorance et ma naïveté, j’avais pensé au départ qu’ils étaient du cru de celle qui les interprétait, mais non. Ces chansons qui cultivent le double-sens avec la même véhémence qu’ils revendiquent crûment leur hédonisme, leur féminisme ou leur goût pour des amours volontiers saphiques, sont signées Suzy Solidor (Ouvre, de 1934), Françoise Hardy, Edith Piaf, Colette Renard (les étonnantes Nuits d’une demoiselle, 1963) ou même… Louise Bourgeois. Tout s’explique.
Pourquoi «Salopes»? Parce que ces femmes qui parlent par la voix de Laurène en sont bien, au sens où l’étaient aussi les signataires, en 1971, du «Manifeste des 343» réclamant le droit à l’avortement (parmi lesquelles Simone de Beauvoir ou Delphine Seyrig): des femmes libres, désireuses de faire valoir leurs droits, et libres de le clamer haut et fort…
Cela – ce propos politique, qui, là encore, est moins affaire de «caution» que de «filiation» – donne paradoxalement au concert un regain de puissance et de fraîcheur: une fois compris le principe, on n’a plus qu’à s’accrocher à ces mots et à cette voix, à ses accords tour à tour riches et étiques, et à se laisser emporter et ravir.
Le moment est parfaitement opportun, ensuite, pour accueillir comme il se doit les «chansons impopulaires» de Frédéric Le Junter. Encore un musicien (cf. Lionel Marchetti la fois d’avant) qu’il m’aura fallu attendre Bordeaux et 2019 pour découvrir en live.
«Prenez-vous la tête les uns les autres / les unes les autres»: dès le «refrain» du premier morceau, déblatéré par Le Junter déguisé en savant fou, on est dans l’ambiance, et d’emblée conquis par tant de hardiesse, de jusqu’au-boutisme, de générosité débridée: Le Junter part littéralement en live à travers ces chansons politiques ou domestiques, mâtinées d’accent ch’ti et de dialecte flamand (flamand rosse, forcément), de calembours capillotractés d’anthropologue oulipien; le tout, sur un instrumentarium home-made qui aimante le regard: commandant à une foule de machines de sa fabrication, le plus souvent rudimentaires et dérisoires; une basse qui se joue avec les pieds, un mini-tourniquet de fortune (sa «groove-pas-box») dont la rotation enclenche un joli breakbeat hip-hop, à chaque chanson sa trouvaille – je me rappelle en particulier cette incroyablement envolée en mode techno hardcore lo-fi… Ces chansons qui sont aussi saynètes ou situations font penser à Albert Marcœur, à Pascal Comelade ou Pascal Battus, entre autres mavericks incurables d’une certaine tradition française… rejetons improbables mais spirituels d’Alphonse Allais, Raymond Queneau ou Raymond Roussel… La verve et l’enthousiasme de Le Junter sont en tout cas contagieux, son engagement, désarmant, chacun en prend pour son grade, les jeunes comme les vieux, les oreilles comme les yeux, lors de ce happening où, effectivement, quelque chose se passe… C’est, une nouvelle fois, virtuose et brut, sauvage et savant, modeste et démesuré – un mélange de maîtrise (car Le Junter enchaîne sans temps mort, et manie à merveille ses multiples machines) et de lâcher-prise, à la fois fougueux et, avant tout, joyeux.
Lou est contente de sa soirée, moi aussi, une nouvelle fois, et avant de rentrer et de reposer mon stylo, je repense à ce que m’écrivait récemment Sabine Opalinski-Benguigui, directrice du Centre d’animation Saint-Pierre, que j’interviewais – en préparation pour un article finalement jamais paru dans Junk Page – sur la présence de la musique dans son établissement, et sur son compagnonnage au long cours avec Einstein On The Beach: «Être bousculé ne nous fait-il pas un peu plus avancer? Donner à entendre, à voir, à écouter la différence, ne participe-t-il pas à nous ouvrir aussi aux autres et à ce qui nous entoure ? On ne peut pas uniquement parler d’ouverture au monde et à l’autre dans notre projet associatif si nous ne tendons pas un peu à aller vers ce qui nous est un peu étranger…» Et j’avais envie de lui laisser le mot de la fin – tant les mots qu’elle emploie (je l’interrogeais sur ses meilleurs souvenirs de concerts au Centre) décrivent parfaitement ce qui s’est produit, ces 26 mars et 9 avril derniers :
«Il n’y a jamais eu un concert sans surprise ou sans émotion… mais un soir, une voix, celle de Beñat Achiary, comme un frisson qui vous parcoure la peau et là je regarde le public. D’abord je remarque le silence comme une attention, une concentration sur ce chanteur aux mille voix, puis çà et là des paupières closes comme pour mieux s’imprégner de ces sons mélodieux, des têtes en arrière comme pour mieux recevoir, des corps qui se laissent choir au fond de leur siège, des larmes qui perlent sur des joues comme un trop-plein d’émotions…Ce fut un moment pour moi extraordinaire parce qu’il y avait la magie du temps suspendu, l’impression d’être dans un ailleurs, la communion entre les personnes et l’artiste… Comme un moment de grâce qui vous habite longtemps.»
David Sanson