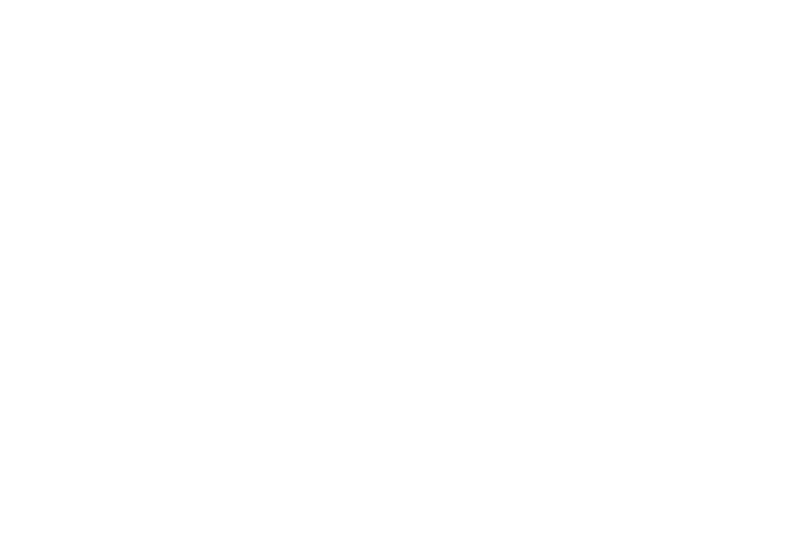ÉCRIRE DESSUS #6
PAR DAVID SANSON
Lionel Marchetti (en solo et avec Michel Doneda)
au Centre d’animation Saint-Pierre, Bordeaux, 2 février 2019
Où sont les notes ?
Dire qu’il aura fallu attendre ce samedi 2 février 2019 pour qu’enfin j’assiste à un concert de Lionel Marchetti. En conclusion d’une plantureuse Semaine du Son orchestrée de main de maître, comme chaque année, par François Vaillant autour du Centre d’animation Saint-Pierre – Semaine à laquelle je n’ai pu malheureusement prendre part, retenu que j’étais sous d’autres cieux –, le voici donc ce matin-là qui s’approche de sa table, sorte de grand oiseau gris-bleu au physique rétro, sa table de mixage s’entend, laquelle, câblée à un quatuor de haut-parleurs, sera son unique instrument lors de ce concert – ainsi que j’entreprends de l’expliquer à ma fille, assise à côté de moi dans l’opulent canapé. Mais où ai-je donc bien pu fourrer mes notes, ces quelques lignes que j’avais alors réussi à griffonner malgré mon état second, à soustraire à l’hypnotique vague de son qui tous nous emporta ?
Qu’à cela ne tienne, il y a le magnifique coffret monographique de CD que vient de publier l’ami Franck (Laplaine) sur son label Sonoris (http://www.sonoris.org/), qui contient entre autres cet Océan (de la fertilité) que l’on va entendre, et que l’on peut par ailleurs écouter sur Bandcamp (https://lionelmarchetti.bandcamp.com/track/oc-an-de-la-fertilit-2016-composition-de-musique-concr-te). Une pièce avec laquelle Lionel Marchetti apportait, en 2016, un point final à son monumental projet ATLAS, « labyrinthe sonore » en 7 « Cercles » et 97 compositions entamé dès 1987, grand-œuvre dont la prolifération (la composition) s’est effectuée de manière quasi organique, à partir des dizaines d’heures de son – esquisses, bribes d’œuvres ou simples archives sonores – accumulées par lui au fil de son déjà long parcours (il est né en 1967), ainsi qu’il s’en expliquera dans une passionnante discussion d’après-concert. Une pièce dont le titre comme le « principe » m’en évoquent irrésistiblement une autre, cette fois du plasticien Gerhard Richter, que j’avais pu découvrir au siècle dernier (c’était à la documenta X de Kassel) : un Atlas non moins monumental, mais constitué en l’occurrence de milliers de photographies (personnelles ou extraites de magazines), de coupures de journaux, de dessins et autres projets accumulés par Richter depuis la fin des années 1960 jusqu’à aujourd’hui, je me souviens que ces archives étaient présentées alors dans d’anonymes armoires de rangement de métal gris dont il fallait tirer les innombrables tiroirs, l’« oeuvre » se découvrant alors par fragments, et par effraction. Archives sauvées des eaux : cette débauche d’ébauches m’évoque également le titre d’une pièce de Luc Ferrari.
La seule chose dont je me rappelle à leur sujet (je parle de ces fichues notes), c’est qu’elles commençaient par un substantif écrit en capitales : le mot de POETIQUE, le premier à me traverser l’esprit ce jour-là, après quelques minutes (la pièce en compte une trentaine).
Il n’est pas très original, la poétique est en effet l’une des notions qui revient le plus régulièrement dans les commentaires sur la musique de Marchetti ; et la poésie imprègne fortement les textes figurant dans le livret du coffret Sonoris, traversés de métaphores et d’analogies, comme si seuls les éléments et les matières, les sensations et les textures, l’espace et le déplacement s’avéraient opérants, autrement davantage que les concepts, pour rendre la dimension proprement concrète de cette musique… La vraie musique : celle qui convoque la poésie avant la musicologie.
Après quelques minutes de concert, donc, j’écris ce mot, POETIQUE, car alors l’oeuvre – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – a commencé à réellement s’éployer. Et alors il faudrait même mettre ce « réellement » en italiques, parce que c’est avant tout une sensation physique que l’on ressent bel et bien à l’écoute de cette musique – de ces textures littéralement hallucinantes, matière sonore en perpétuelle mais si discrète et si délicate fusion – qui prend corps autour de nous.
Rarement j’ai autant ressenti la dimension proprement concertante de ces concerts que l’on appelle aussi « diffusions » ; rarement (je me rappelle surtout certaines pièces de Ferrari ou de Philip Jeck entendues naguère au festival Présences électronique) j’ai autant éprouvé le caractère éminemment vivant, la physicalité de la multiphonie, de cet orchestre de haut-parleurs, fût-il simple quatuor, disséminés autour de nous, qu’en entendant se déployer les premières sonorités de cet Océan (de la fertilité). Sonorités comme venues de nulle part et pourtant telluriques, surnaturelles et puissamment concrètes, nappes cristallines et surréelles, comme des sirènes de navires perdus dans le brouillard (ou bien ne serait-ce pas des sirènes tout court, celles d’Ulysse ?), et qui, même maintenant, à présent que je les réécoute en stéréo, gardent tout leur pouvoir, toute leur force d’attraction (pouvoir que la multiphonie, logiquement… démultiplie).
Et peu à peu, derrière, émergent comme des vagues – la partie centrale se fait plus « concrète » et plus dense, puissante, presque industrielle, le bruit du ressac et la clameur des mouettes transperçant le brouillard. Plus houleuse, aussi, plus sombre. En les réécoutant, ces bruits de vagues, je songe aux plus spectaculaires marines des peintres d’hier ou d’aujourd’hui, les flamandes ou les anglaises, celles d’Ivan Aïvazovski ou Thierry de Cordier…
Une pulsation grave se fait entendre, de plus en plus percussive, des crissements, une sorte de signal électronique, tout cela semble s’agencer, s’orchestrer, se développer et se répondre presque miraculeusement, c’est-à-dire : naturellement.
Le signal électronique persiste, surnageant parmi une infinité de plans sonores, vagues indénombrables et indissociables, dominant des rumeurs guerrières, des voix méconnaissables, distordues et hantées, convoquant les esprits des océans et les visions les plus oniriques.
Neige de printemps
C’est le vent qui finit par emporter la pièce, luttant contre un grondement sourd, menaçant, vrombissement qui semble d’un avion volant au-dessus des nuages épais et gris, l’un et l’autre s’évanouissant lentement, indéfiniment, dans le silence. Et c’est ma fille (elle a décroché dix minutes avant la fin, mais je dois avouer mon heureuse surprise : la voir si captivée pendant un bon quart d’heure par cette musique dense et austère, elle qui n’aime rien tant qu’écouter des histoires, ne m’a fait que mieux prendre la mesure de la dimension narrative de ce que nous étions en train d’’entendre ; comme quoi cette musique – même si elle fascine le musicien aussi par le caractère magistral de sa facture, si parfaitement équalizée, par cette manière sculpturale qu’a Marchetti de traiter les sons – n’a rien d’abstrait, bien au contraire – et là je ne peux que citer à nouveau ces mots du poète écossais Kenneth White, que Marchetti aime à reprendre au sujet de sa musique concrète : « J’aime l’abstrait où subsiste un souvenir de substance, le concret qui s’affine aux frontières du vide… »), c’est ma fille, donc, qui emmerde tout le monde (en tout cas au moins une spectatrice, ai-je eu l’impression, et aussi un peu son papa) en mêlant à ce silence en passe de s’installer les bruits produit par ses griffonnements (il est vrai relativement bruyants) sur les coloriages qu’on avait eu la gentillesse de lui donner…
Elle est faite de tout cela aussi – sans doute – la poétique de Lionel Marchetti. Voilà bien une musique qui invite à la poésie, qui incite au lyrisme. Plutôt que de continue à m’épancher, je préfère penser à ces mots de Jean Mambrino figurant sur la page Bandcamp susmentionnée :
« Parmi toutes les pensées
du monde
d’où vient cette intention
de l’oiseau
et du vent ? »
Ou encore à ces lignes que je viens de trouver sur Wikipedia (lien), extraites du roman Neige de printemps, premier volet de La Mer de la fertilité, tétatrologie-testament de Yukio Mishima – elles sont en l’occurrence si éloquentes :
« Je voyais distinctement la mer qui resplendissait et la plage brillante, telles qu’elles étaient vraiment. Pourquoi n’ai-je pas su voir la modification subtile survenue en profondeur dans la substance de l’univers? Le monde changeait constamment, imperceptiblement, tout comme le vin dans une bouteille… »
Neige de printemps : un titre qui pourrait seoir à une composition de ce grand musicien qu’est Lionel Marchetti, architecte de la sensation, alchimiste des éléments et de la matière.
(Aparté : Me revient aussi cette longue conversation d’après-concert avec mon ami Rainier (Lericolais) et Julia (Hanadi Al-Abed), autour notamment de ce mot de « diffusion ». Ou bien était-ce la veille, lors du vernissage de l’exposition et du concert (puissant et étonnant, dans l’esprit d’un Nurse With Wound) de Bernard Szajner organisés par l’association 6click Culture dans les espaces des Vivres de l’art ? Julia nous avait dit préféré, quant à elle, le terme de « projection », dont j’aime la double résonance à la fois physique et cinématographique…)
Voyage buñuelien
Et ce n’est pas fini.
Le soir même en effet, ou plutôt en fin d’après-midi, après le Lionel Marchetti compositeur, orfèvre de l’écriture du sonore, c’était au tour de l’improvisateur de démontrer ses talents, toujours au même endroit, cette fois aux côtés du saxophoniste Michel Doneda. Rencontre au sommet à laquelle il ne m’a malheureusement pas été donné d’assister (je donnais moi-même un concert le lendemain, il me fallait bien un tantinet préparer icelui). Mais j’avais pu écouter une improvisation antérieure sur Internet (Bandcamp, toujours – https://lionelmarchetti.bandcamp.com/track/doneda-marchetti-montpellier-2018-improvised-electronic-music-concert) et ainsi mesurer l’ampleur de la chose. Les incroyables extrémités sonores auquel l’un et l’autre s’amènent mutuellement. Les admirables collisions de textures, horizons sonores inédits que l’on imagine plus fascinants encore en live, duel et duo en direct de quatre haut-parleurs et d’un saxophoniste, dialogue entre l’électronique et l’acoustique, entre deux musiciens-chercheurs également virtuoses de leur outil. Autant de promesses d’une dilatation singulière de l’espace-temps.
Surtout, j’ai pu écouter en différé (et en stéréo) ce concert du 2 février, qu’a heureusement enregistré Loïc (Lachaize) :
Ça dure 45 minutes, ponctuées de deux brèves pauses. Le voyage commence par des souffles et des sifflements, on croirait entendre (pour rester concrets) une flûte orientale et un synthétiseur, on a d’emblée envie d’y être (il y avait plein de monde, en plus, paraît-il) pour voir de ses yeux comment tous ces sons sont produits, d’où ils proviennent, ces vents qui semblent strier l’espace, ces ondes extra-terrestres qui perforent ou percutent, ces bourdonnements qui m’évoquent la forêt d’insectes géants menaçant le petit garçon des Maîtres du temps, le dessin animé de René Laloux et Moebius. Tantôt dans l’opposition, tantôt dans l’osmose, tantôt dans la fusion, tantôt aux confins du silence, Marchetti et Doneda progressent ensemble dans un périple qu’il s’agit de rendre palpitant, périple aux allures souvent transcontinentales, et constamment guidé par la surprise. Surprise de voir ses propres habitudes, ses savoir-faire accumulés remis une nouvelle fois sur le tapis, savoir accueillir cette sensation et en même temps la rendre malléable, cette matière sonore, pour mieux la pétrir dans l’instant et la redonner (« Ce que tu donnes t’appartient, ce que tu retiens est perdu à jamais », dit le proverbe – mais peut-être l’ai-je déjà dit?) au partenaire de jeu. D’où sortent ces sonorités qui semblent de percussions saturées, ces matières et ces magmas, ces bruits de nature et d’ailleurs, ces prodigieux objets électroniques ? Quel instrument, quelle machine ou quel musicien peuvent les produire, par quels subterfuges ?
Les atmosphères varient, aux tempêtes succèdent les accalmies, mais toujours la lumière est changeante, toujours les scènes sont différentes qui paraissent s’enchaîner avec une logique dramaturgique aussi imparable que celle d’un songe buñuelien. Il y a des moments de bruit et de furie, d’autres moments de drone et d’euphonie, une succession de paysages et de couleurs. Parfois aussi quelques toux dans les rangs du public.
Silence.
Les étapes suivantes de ce périple improvisé sont l’occasion pour Marchetti et Doneda d’explorer encore d’autres contrées inconnues (d’eux comme de nous), de continuer à s’aventurer de concert en faisant fi autant que possible des repères et des cartographies. Elles m’ont paru à l’écoute monter encore en puissance par rapport à la première. Mais décidément, me dis-je une nouvelle fois, qu’il est difficile d’écrire sur l’improvisation autrement qu’en employant des généralités et des « grands mots » ! – Mais c’est aussi que foin des formules pompeuses, il faudrait pouvoir décrire précisément chacun des sons qui est à l’œuvre à chaque instant, et aussi l’effet particulier produit par leur association, et par leur déroulement, arriver à en dégager quelques idées générales qui se trouveraient aussitôt remises en jeu, et en question – et que tout cela prendrait des pages…
Faut-il conclure ? Oui, pour préciser que Lionel Marchetti sera de nouveau à l’honneur au début de l’été, le 3 juillet au Jardin Botanique, aboutissement de la résidence qu’il mène actuellement au Centre d’animation Saint-Pierre. Et pour citer Yan (Beigbeder, who else?), instigateur de la résidence en question, qui m’écrivait voir en lui « un des artistes capables d’explorer le monde du son avec le plus de radicalité sauvage ». Encore une autre manière d’être poète.
David Sanson