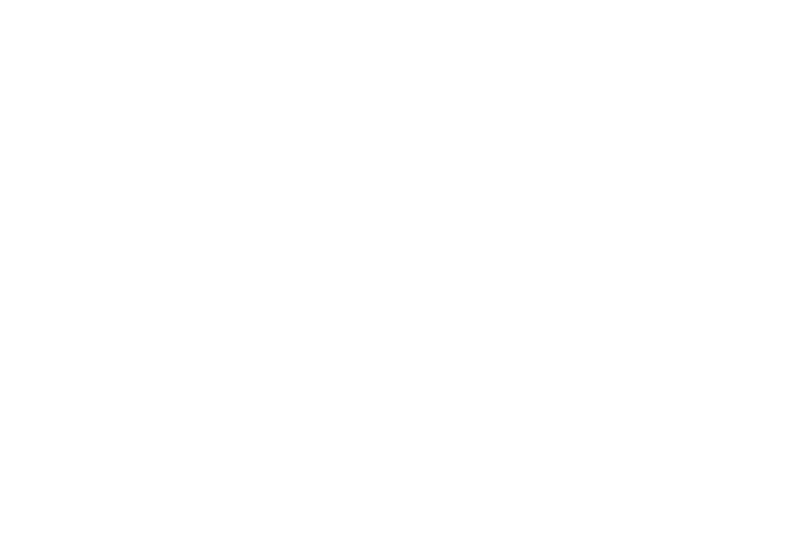ÉCRIRE DESSUS #3
PAR DAVID SANSON
LE MARDI AU ZINC – 16 OCTOBRE 2018
Avec
PIERRE LACHAUD SOLO
FRANÇOIS CORNELOUP SOLO
MATHIAS PONTEVIA & JESUS AURED
(Apparté n° 1 : Laisser décanter. Ecouter les notes sans en prendre, de notes, à la fois pour mieux entendre et pour écrire différemment. Se fier au seul prisme du souvenir. Car après tout, même si elle ne saurait être l’unique gage de l’intensité émotive d’un concert (il est certaines émotions intenses qui disparaissent en effet aussi subrepticement qu’elles étaient survenues), la valeur d’une musique ne se mesure-t-elle pas à sa postérité, à la trace fût-elle intime, subjective et personnelle, unique, qu’elle a laissée, via nos tympans, sur notre propre mémoire ? Laisser affleurer les sensations, aussi fugaces et fragmentaires soient-elles, mais aussi toutes les pensées adventices, périphériques, qui se présentent.)
Le roi des gongs.
Ce deuxième volet des « Mardis au Zinc Pierre » organisés par Einstein On The Beach – pour une présentation détaillé de ce cycle, voir «Ecrire dessus #2» – commence légèrement plus tard que le précédent, à 17 heures 45 sonnantes. Cela laisse le loisir d’examiner la «batterie de cuisine » de Pierre Lachaud qui s’étale sur un tapis : un amoncellement de cloches, cymbales, gongs et gamelles, de plats en inox et de moules à tarte parfois éparpillés comme les écailles d’une carapace, parfois dressés en colonnes façon cairn.
Cairns que le percussionniste fou va d’abord s’attacher à mettre à bas, laissant les « instruments » s’entrechoquer ou les carambolant de la main ou de la baguette, les laissant s’animer sous nos yeux, résonner et déraisonner « du calme à la tempête », ainsi que je le promettais dans le communiqué que j’avais rédigé pour annoncer cette soirée. Ce dont je garde le plus vif souvenir, ce sont tous ces passages où Pierre Lachaud, à grands renforts de rythmes martiaux et néanmoins hypnotiques, laisse libre cours à son amour pour la musique industrielle des années 1980, ces groupes tels que Test Department ou Einstürzende Neubauten que, tout comme moi, il m’avouera après-coup avoir – entre mille autres choses, du blues aux Bérus – beaucoup écoutés naguère. Le concert est bref, et l’on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer au fil de cette vingtaine de minutes de « musique animée », mue par une dramaturgie percutante qui captive aussi les enfants, eux qui savent le plaisir primaire qu’il peut y avoir à taper de toutes ses forces sur une casserole, emportés à leur tour dans la polyrythmie trépidante et jouissive d’un musicien au physique de cartoon, dont par moments le corps frêle et sec semble fusionner avec ses ouailles métalliques, morceaux de chair contre morceaux de fer.
La bête de sax.
Un corps, du métal cuivré. C’est encore l’image qui s’impose lorsque je repense au second solo de la soirée, celui que livre le saxophoniste François Corneloup, autre fidèle d’Einstein On The Beach, à l’heure de l’apéro. Corps vertical, et non plus agenouillé, presque immobile, imposant d’emblée une physicalité stoïque, marmoréenne. C’est un lieu commun que de dire d’un instrumentiste qu’il fait corps avec son instrument, mais en l’occurrence, c’est bien une telle osmose qui a lieu ce soir-là sous nos yeux, entre Corneloup et son saxophone baryton, à travers cette chevauchée fantastique de près de trois quarts d’heure. Typiquement le genre de concert qui, même s’il m’a emporté, déconcerte le chroniqueur que je suis, d’autant que je suis loin de vouer au saxophone la même affection intime que Yan, dans son laïus introductif, avoue lui porter. Il me manque à moi la densité harmonique, la puissance polyphonique du piano, de la guitare, de l’accordéon ou même du violoncelle. Surtout, j’ai beau avoir beaucoup entendu, programmé, et même pratiqué – à la faveur d’un «Cobra» jadis dirigé par Quentin Sirjacq – la «musique-improvisée», celle-ci pourtant se dérobe à mon entendement, et plus encore à ma plume. Comment démarre une improvisation ? dans quelle mesure est-elle le fruit de l’atmosphère environnante ? Qu’est-ce qui est planifié, qu’est-ce qui ne l’est pas dans cette musique dont, manifestement et de surcroît, je n’ai pas les mots et les référents qu’il faut pour la « juger » ? Au-delà de la question de la virtuosité, au-delà de tous ses aspects codifiés, comment parler d’une improvisation autrement qu’en convoquant généralités et platitudes, qu’en déployant un éventail de métaphore éculées, poétiques et vaguement mystiques, autour du miracle de l’instant et de la grâce de l’inspiration – alors même que cette musique est, par nature, censément toujours neuve ?
(Apparté n° 2 : Cela me rappelle un chroniqueur avec lequel j’ai eu l’occasion de travailler par mon passé de rédacteur en chef. Je trouvais ses chroniques de disques de musique improvisée souvent trop générales bien que plutôt élégantes, bardées des métaphores poético-éculées susmentionnées, ne citant jamais les titres des morceaux, au point que d’un mois à l’autre, ses commentaires eussent pu paraître interchangeables – ils étaient valables en définitive pour tous les disques d’improvisation. Jusqu’au jour où j’ai retrouvé, dans le texte d’une de ses chroniques, quatre phrases qu’il me semblait avoir lues quelque part. Et pour cause : elle provenait de l’essai biographique que j’ai moi-même consacré à Maurice Ravel aux éditions Actes Sud. Quatre phrases probablement mystico-éculées sur le miracle de l’inspiration ou l’euphorie de l’euphonie, quelque chose comme ça – que le chroniqueur avait gaiement pillées, à une date suffisamment reculée pour oublier entre-temps d’où elles provenaient et avoir à présent le culot de me les présenter. Je me suis dit que probablement tous les textes qu’ils m’avaient rendus par le passé procédaient eux aussi du même procédé, copier-coller scolaire de phrases sonnantes et trébuchantes empruntées à droite à gauche, j’ai imaginé la tronche de son répertoire, son « dictionnaire de citations »… Inutile de dire que nous avons fini par nous brouiller. Il n’empêche que cette anecdote me paraît révélatrice non seulement de la tartufferie de certains journalistes, mais aussi et surtout – à la décharge du tartuffe en question – de cette difficulté que le langage peut éprouver à rendre compte de l’irréductible individualité et de l’impondérable spontanéité qui sont à l’œuvre dans la pratique de l’improvisation, a fortiori en public.)
(Apparté n° 3 : Ecrivant cela, je me suis rappelé aussi ce que me disait récemment le compositeur François Sarhan : « La spécialisation, c’est plus une maladie qu’une solution. »).
Face à ce gap sémantique, c’est Yan qui, as usual, sera le sésame. Au terme du concert, après que je lui ai fait part de mon désarroi, il me répond tout de go qu’il aime avant tout la musique de François Corneloup pour sa dimension « romanesque ». Bingo. C’est bien le qualificatif qui convient pour décrire ce solo qui m’a effectivement transporté à travers une succession de rebondissements. Débutant par la répétition interminable d’un motif, sa variation impalpable au fil du souffle et de l’énergie propulsée par le corps du musicien-narrateur, de plus en plus bruitiste, pour ensuite faire évoluer l’auditeur comme à travers une suite de vagues, vagues sonores qui brossent autant de paysages et d’atmosphères, bourdons et sirènes de navires, didgeridoo et flûte berbère, cuivré ou soyeux, jusqu’à l’infiniment petit, et au silence. Un corps, du métal cuivré, mais aussi, je m’en souviens maintenant, un chant.
La voix de Jésus.
Le dernier concert, je l’ai vécu comme un rêve. Après ces deux solos, il s’agissait cette fois d’un duo entre deux autres familiers d’Einstein On The Beach : le «batteur» (un mot qui semble bien réducteur dans son cas, tout autant que «percussionniste ) Mathias Pontevia et l’accordéonniste-chanteur Jésus Aured.
« Vibrant à l’unisson, l’un et l’autre élaborent un monde sonore organique, une sculpture vivante laissant libre cours à leur amour du dialogue, entre les musiciens comme entre les musiques »: écrivais-je avant le concert. Mais oui : toute auto-satisfaction mise à part, c’était exactement cela. Tout de suite j’ai fermé les yeux et tout de suite – après avoir de nouveau songé à ce hiatus entre la vue et l’ouïe, m’être demandé si un concert ne s’apprécie pas forcément les yeux fermés – il m’a semblé entendre des instruments électroniques. Des synthétiseurs d’outre-tombe. Les textures sombres, impalpables mais luxuriantes, irréellement denses déployées par Jésus Aured m’ont fait penser à Pan Sonic, à Mario de Vega.
(Publi-rédactionnel : Et en repensant à Mario De Vega, musicien mexicain que pour ma part j’ai découvert l’an passé ici même, au Centre d’animation Saint-Michel, grâce à un fantastique concert avec Pascal Battus organisé par Einstein On The Beach, je me suis dit que cette association, tout de même, n’avait guère d’équivalent en matière d’ouverture musicale et de pluralité esthétique – entre Mario De Vega, Pantxix Bidar, The Ant, Taranta ou aujourd’hui ce duo, il y a un monde et pourtant aussi d’évidentes affinités, une même inclination vers la recherche qu’induit toute rencontre, et une même propension au polymorphisme. Une ouverture musicale dont on s’étonne qu’elle ne soit apparemment pas partagée par davantage de monde…)
Ce sont donc des climats très sombres que déploient pour commencer les deux musiciens, qu’il font ensuite évoluer de manière quasi organique au fil d’un concert où l’on retient en permanence son souffle, où l’on se tient souvent au seuil du silence, entre autres abîmes. Sombre aussi, gravissime le plus souvent, la voix de Jésus Aured, qui me fait parfois penser à Michael Gira (Swans) période gothique – il n’y a pas que les métaphores éculées, il y aussi les références dont il est difficile de sortir lorsque l’on parle d’une musique, quelle qu’elle soit –, participe de cette atmosphère onirique, voire fantastique. Mathias Pontevia, quant à lui, soumet ses fûts, ses cymbales et ses peaux à une multitude de traitements, en tirant des sons inouïs (on n’oubliera pas la résonance produite par le crissement d’une cymbale sur la peau du tom basse). La richesse des textures créées par Pontevia et Aured, séparément et ensemble, serait de peu de prix si elle n’était cultivée que pour elle-même et non, comme c’est le cas ce soir, prise dans une savante trame narrative d’ensemble – une trame narrative qui n’en ménage pas moins suffisamment d’échappées permettant aux musiciens de s’adonner à la contemplation, loin de tout format homologué ; s’il elle n’était, surtout, nourrie par une entente musicale peu commune – comme le sont nombre des rencontres qui se produisent au Zinc Pierre, un mardi par mois.
David Sanson