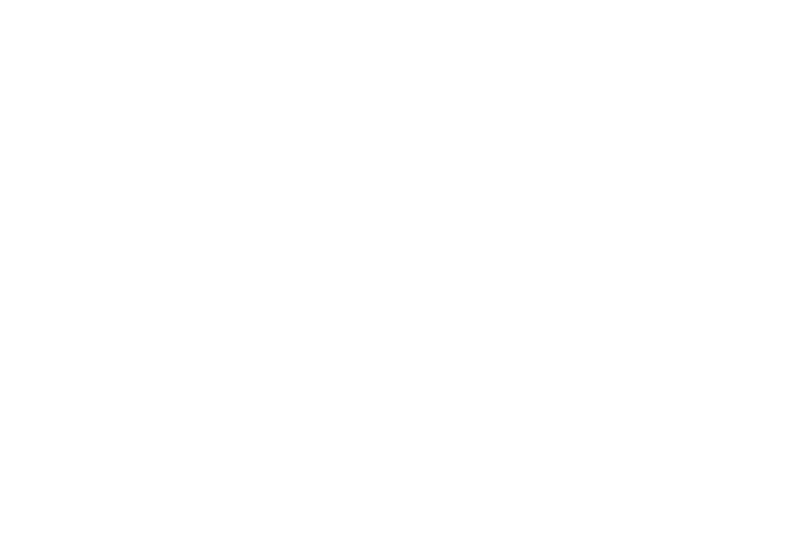© Photos : Bruce Milpied, Hans Studio
ÉCRIRE DESSUS #4
PAR DAVID SANSON
IL TEATRO – 1er NOVEMBRE 2018
Avec
URS GRAF CONSORRT
Round 1. Apocalypse exotique
Sans transition, en franchissant le seuil du Teatro après avoir raté le début de ce premier round de « Duos & Duels », on entrait d’emblée dans un autre monde. Une cacophonie certes des plus joyeuses, mais aussi des plus déroutantes, free en diable, émanant de trois musiciens, puis quatre, passant d’un instrument à l’autre, plongeait la salle du bar dans une euphorisante impression d’hébétude et de curiosité.
J’avais lu en diagonale – comme Yan me l’avait enjoint – le texte qu’une fois n’est pas coutume, je n’avais pas écrit pour annoncer cette soirée d’Einstein On the Beach, j’avais retenu les mots de « cavités résonantes », de « cordes vocales », d’« organes » et autre « brame du cerf », et bizarrement, je m’étais préparé à entendre des chanteurs répartis en duos. Or la voix n’est que l’un des multiples instruments auxquels s’adonnent les quatre musiciens en présence (et quelle présence !) : et les duels annoncés, Joel Grip (contrebasse), Simon Sieger(accordéon, trombone à piston, tuba), Adrien Bardi Bienenstock (voix, nez, bouche, mains, mais aussi tambour) et Prune Bécheau (violon baroque, mais aussi synthétiseur Nord) ont choisi de les livrer au détour de longs morceaux en quatuor, morceaux qui déploient des climats dont les perpétuels contrastes paraissent traduire une folle spontanéité. Musiciens cosmopolites – leurs parcours respectifs font s’entrecroiser la Suède et la Meurthe-et-Moselle, la Dordogne et l’Inde, Berlin et Marseille – comme l’est leur musique, qui m’apparaît à ce moment-là – et même après que l’explosion de dissonances initiale s’est dissipée, dissoute dans d’autres paysages, voire d’autres galaxies sonores – comme radicalement exotique.
Alors, en entendant tous les échos de folklores imaginaires dont cette musique était réminiscente, c’est, allez savoir pourquoi, à Mauricio Kagel (1931-2008) que j’ai pensé. Et plus particulièrement – parmi le foisonnement d’œuvres de ce compositeur génial au parcours passionnant – à ce duo de pièces écrites en 1970-72 pour instruments atypiques, Acustica et surtout Exotica, dans lesquelles l’inventivité sonore et l’irrévérence artistique se doublent d’un magique travail sur la mémoire musicale. Un peu à l’image du promeneur du non moins magique Central Park in the Dark de Charles Ives (pièce orchestrale de 1906 dont le titre premier était : A Contemplation of Nothing Serious), on croit percevoir, en provenance de tous les points du globe, des échos de fanfare, de dancings ou de fêtes de villages, qui résonnent comme floutés par quelque brouillard auriculaire à travers le brouhaha ambiant.
J’ai pensé « Kagel » car j’ai aussi pensé « théâtre musical », en considérant la salle du bar, ce brouhaha ambiant, en observant les gens plongés comme moi dans cette euphorisante impression d’hébétude et de curiosité. Car c’était bien un vrai théâtre qui se jouait sous mes yeux parmi la foule qui emplissait le Teatro ce soir-là – foule dans laquelle je reconnaissais Isabelle, Yan, Elsa, Christophe, Christophe, Mathias, entre autres –, un théâtre involontaire, fortuit et éphémère, une scène de cabaret qui ne serait plus jamais la même et dont j’étais partie prenante. Avec ces lumières rougeoyantes, ces rangées de miroirs, de verres et de bouteilles, cette pénombre néanmoins lumineuse, où brillait une gaieté singulièrement contagieuse, j’avais la sensation de me trouver dans un décor, dont la musique qui s’y produisait ne faisait que rendre plus saillante encore la dimension fantasmagorique. C’était théâtral, mais aussi cinématographique, on se serait cru chez Fellini voire chez Kusturica, ou même pictural (Brueghel ou George Grosz), les musiciens chantaient tantôt en italien, tantôt en allemand, s’exprimaient par gargarismes ou par borborygmes, les spectateurs suivaient, et je ne savais plus trop ce qui se passait, et encore moins comment définir cette musique à la fois virtuose et ingénue qui, mêlant à des gestes savants une inventivité quasi dadaïste, imprimait mes tympans. Une performance totale, baroque, volcanique, dont j’étais à la fois le spectateur et l’acteur.
Round 2. A contemplation of nothing serious.
Le round 2 m’a happé du début à la fin, effet conjugué de ses sortilèges musicaux et de ma position particulière de spectateur – une station debout (et compressée) peu propice à la prise de notes. Aussi bien, la prise de note n’est-elle pas, elle-même, peu propice à l’écoute ? Qu’il est difficile, grands dieux, de devoir conjuguer ainsi l’écoute et l’écriture ! Prendre des notes, c’est certes la seule manière de fixer des moments par nature fugitifs – et ils le sont d’autant plus dans le cas d’une musique semblablement contrastée, continuum dont les permanentes ruptures de ton font passer l’auditeur d’un univers sonore à l’autre à la vitesse de la lumière, et sans crier gare – mais c’est aussi, malheureusement, se résoudre à « décrocher », à suspendre son attention, au risque de rompre ce que le pauvre Cyril Hanouna appellerait sans doute « la magie du direct »… Insoluble dilemme du plumitif, en attendant l’invention d’électrodes qui relieraient directement la main au cerveau.
Au début, c’est surtout la voix d’Adrien Bardi Bienenstock qui a retenu mon attention : cette façon de rendre le texte qu’il lit – une absurde fiche technique liée aux chiens, si je me rappelle bien – étrangement inaudible ; mais depuis le début, la manière totalement décomplexée dont les protagonistes jouent de la voix est l’un des caractères les plus marquants de leur performance – déjà dans le Round 1, leurs voix étaient tour à tour chantées, parlées ou « bruitées », tantôt déclamées, tantôt complètement désarticulées, soumises aux mêmes expérimentations que tous les autres instruments… Mixés au même niveau que ces derniers, les mots d’Adrien Bardi Bienenstock semblent en outre patinés par un souffle, un crachotement qui évoque celui des vieilles cassettes audio. On n’y comprend goutte mais il n’y a rien à comprendre, de toute façon, ce n’est que par bribes que le texte peut devenir poétique…
Faute de notes donc – écrivant cela, et toutes proportions gardées bien sûr, je pense au mot lapidaire de Joseph II à l’égard du compositeur de L’Enlèvement au sérail : « Trop de notes, monsieur Mozart, trop de notes ! » –, je ne me rappelle plus dans le détail ce qui a suivi. J’ai dans la tête des échos de fanfare, de dancings ou de fêtes de villages semblant provenir de tous les points du globe, les visages d’un public de plus en plus captivé par lesdits échos tour à tour endiablés et rêveurs, enfiévrés et méditatifs, par cette musique dans le même mouvement intimiste et maximaliste.
Je me rappelle en revanche que vers la fin – c’est un signe rare, qui ne trompe pas, et c’est un énorme compliment de ma part – j’ai irrésistiblement pensé à Coil. Simon Sieger entonne au tuba une ligne de basse assez dark, qui me rappelle confusément The First Five Minutes After Death (sur l’album Horse Rotorvator, chef-d’oeuvre de Coil paru en 1986), ligne sur laquelle ses comparses viennent poser des harmonies et des textures qui dessinent un moment rare, comme une brève marche funèbre dont le cortège, bientôt, disparaîtrait à l’horizon, aussitôt remplacé par une liesse renaissante. Car le finale n’aura ensuite été qu’un long crescendo, une haletante montée au fil de laquelle les artistes parviennent à entrainer le public dans leur sillage frénétique, quitte à lui faire perdre tout contrôle… Near life experience.
« Ce sont des saltimbanques, finalement », me confie Yan, après le concert, et j’admire une nouvelle fois sa clairvoyance – Yan me semble avoir toujours le mot juste lorsqu’il parle de musique, et en l’occurrence de ces musiciens dans lesquels il voit la version moderne de ces artistes païens, bateleurs et baladins, qui, jadis, déchaînaient les foules sur le parvis des églises… Sur le parvis du Teatro, j’échange mes impressions avec d’autres spectateurs, et une dame me parle avec des mots très justes, eux aussi, de Berio – qui, par maints aspects, n’est pas si éloigné de Kagel – en me disant avoir admiré chez les musiciens de ce soir la perception instinctive qu’ils lui semblaient avoir du folklore… En y repensant, en essayant de ressaisir toutes ces bribes, je retient surtout l’impression d’avoir encore une fois partagé un espace de grande liberté musicale – savante mais jamais sentencieuse ni académique, non pas démonstrative, mais joviale et contagieuse –, un nouveau moment rare. Rares sont en effet les concerts qui vous amènent à crier carrément, à sortir vos tripes en chœur. Rares sont aussi les concerts qui s’achèvent au rythme des battements de mains des spectateurs. Rares sont enfin les concerts où l’esprit peut vaguer librement, et comme naturellement, de Mauricio Kagel à Coil, en passant par Brueghel…
David Sanson